« Une histoire des civilisations » : un compte-rendu paru dans Societés plurielles
La revue Sociétés plurielles a récemment publié mon compte-rendu du livre collectif « Une histoire des civilisations. Comment l'archéologie bouleverse nos connaissances. » dirigé par Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia et Alain Schapp, aux éditions La Découverte.
Le texte est disponible en ligne à cette adresse : https://societes-plurielles.episciences.org/6238/pdf.
Je le reproduis ici :
Cet ouvrage constitue une réalisation d’une ampleur et d’une ambition inhabituelles. En un peu plus de 600 pages de grand format, richement illustrées, plusieurs dizaines d’archéologues contribuent à un tour d’horizon qui embrasse de la manière la plus large qui soit l’état actuel des connaissances de la discipline.La structure proposée tente de dépasser la traditionnelle opposition entre les livres individuels ou écrits par un nombre restreint de spécialistes – qui, par la force des choses, peuvent éprouver quelques difficultés à s’avancer hors de leur domaine d’expertise – et les ouvrages collectifs, qui restituent souvent un savoir érudit, mais fragmenté. L’organisation du texte fait donc le pari de l’hybridation : chacune des cinq grandes parties qui le composent est ouverte par une longue introduction à caractère synthétique, rédigée par l’un des éditeurs (à l’exception de la préhistoire la plus ancienne, signée de Jean-Jacques Hublin), avant d’être suivie par une série de contributions individuelles plus ciblées et concises. Le résultat, qui parvient à un agréable équilibre, est incontestablement convaincant.Ce choix n’est pas la seule originalité de l’ouvrage. Les trois premières parties, de manière assez classique, se proposent en effet de traiter de « l’hominisation et les sociétés de chasseurs-cueilleurs », des « premières sociétés agricoles » et de « l’origine et l’extension des États centralisés ». La quatrième, en revanche, titrée « des empires à la mondialisation » aborde de plain-pied l’ère historique et s’avance jusqu’à la période contemporaine, soulignant ainsi les apports de l’archéologie y compris pour l’étude des sociétés connues par ailleurs via leurs documentations écrites. Enfin, la cinquième et dernière partie, davantage centrée sur l’état de la discipline elle-même, procède à l’inventaire des méthodes et des champs dans lesquels elle se déploie aujourd’hui.À l’ampleur du propos dans le temps s’ajoute son étendue dans l’espace : c’est bel et bien une fresque globale – sinon exhaustive, à l’impossible nul n’est tenu – des sociétés humaines que s’attache à brosser le texte, même s’il évite, ce que l’on pourra regretter, de s’avancer ouvertement sur le terrain d’une théorie explicative de cette évolution. Loin de se limiter à la seule séquence de l’Europe et du Proche-Orient, le livre rassemble de nombreux matériaux venus du monde entier, qui illustrent tout à la fois le mouvement général des sociétés humaines et la diversité des trajectoires locales.Au souci d’un langage clair qui marque l’ensemble des contributions, évitant toute technicité superflue et tout jargon obscur, s’ajoutent des frises chronologiques qui offrent au lecteur une vision synoptique, sur l’ensemble des continents, des principaux marqueurs archéologiques et des grands ensembles sociaux qui s’y sont succédés. Les courtes bibliographies proposées à la fin de chaque contribution sont autant de portes ouvertes à tous ceux qui souhaiteront aller plus loin.Nul ne saurait prétendre – et l’auteur de ces lignes pas davantage que quiconque – posséder les compétences pour discuter l’ensemble des données et des raisonnements contenus dans une telle somme. Les brefs commentaires qui suivent se limiteront donc aux thèmes sur lesquels je me sens en droit d’intervenir.Une première remarque concerne ces sociétés qui, tout en ignorant peu ou prou toute pratique d’agriculture ou d’élevage (le cas particulier du chien mis à part), ont connu une trajectoire socialement similaire à celle que l’on associe traditionnellement à la « révolution néolithique », évoluant vers une sédentarité prononcée, généralement accompagnée de stockage et, surtout, d’inégalités socio-économiques plus ou moins marquées. Celles-ci sont certes abordées dans la contribution de Thomas Perrin qui, dans l’espace restreint dont elle dispose, procède à un tour d’horizon aussi informé qu’équilibré. Il est bien entendu que chacun, en fonction de ses propres centres d’intérêt, aura tendance à considérer que le livre passe trop vite sur tel ou tel aspect ; à moins d’allonger le texte dans des proportions déraisonnables, il a bien fallu procéder à des choix. Néanmoins, parce que ces sociétés constituent pour la vision classique de l’évolution sociale un défi dont elle n’a sans doute pas toujours pris la mesure, peut-être auraient-elles mérité des développements un peu plus amples.Ce regret est encore plus vif concernant la question des courants théoriques en archéologie, qui n’est abordée que très succinctement, notamment par les interventions d’Alain Schnapp et d’Anick Coudart. Mais pour bien des lecteurs, un exposé plus systématique des clivages qui ont traversé la discipline depuis son apparition et, en particulier, des divers débats qui l’ont animée durant les dernières décennies, aurait sans nul doute été un apport précieux, tant leurs enjeux dépassent de loin les considérations méthodologiques pour toucher à l’idée même que l’on se fait des sociétés et de leur évolution.Sur un autre plan, concernant le cas plus particulier de l’Australie, une littérature récente a entrepris de contester l’affirmation traditionnelle selon laquelle ce continent, lors du contact, était dénué de toute pratique se rapportant à l’agriculture. Fait unique parmi les chasseurs-cueilleurs observés à l’époque moderne, l’arc était inconnu et même le chien local, s’il était apprivoisé et élevé, n’était qu’incomplètement domestiqué ; au demeurant, ce fait était semble-t-il beaucoup moins dû aux déficiences supposées des pratiques des Aborigènes qu’aux spécificités génétiques de cette sous-espèce. Quoi qu’il en soit, dans un mouvement dont on peut se demander dans quelle mesure il n’est pas en partie inspiré par les préoccupations politiques de la société australienne actuelle, plusieurs travaux ont récemment voulu insister sur les différentes techniques par lesquelles les Aborigènes géraient leur environnement et s’apparentaient à un certain degré à des cultivateurs. C’est dans cet esprit que s’inscrit la contribution de Tim Murray qui, tout en insistant à juste titre sur l’importance des pratiques de mises à feu du territoire, ainsi que sur les réalisations pérennes tels que les vastes pièges à poissons dans certaines zones du sud-est, s’aventure peut-être un peu trop en suggérant que les haches polies des Aborigènes du Kimberley servaient au défrichage ou en écrivant sans ambages que les poissons pêchés par les communautés semi-sédentaires du Victoria constituaient un surplus formant la base d’échanges réguliers avec les tribus avoisinantes – en tout cas, c’est en vain que j’ai cherché des éléments qui permettraient de tenir cette affirmation pour autre chose qu’un pur raisonnement.Enfin, sur la question de la violence et de la guerre, on peut regretter que la contribution de Marylène Patou-Mathis, qui défend l’idée d’une apparition tardive du phénomène guerrier sur la base de son invisibilité archéologique dans les périodes les plus anciennes, ne laisse pas davantage place aux arguments qui contestent cette thèse, fût-ce pour les réfuter. Bien des archéologues et des ethnologues, notamment dans le monde anglo-saxon, ont en effet souligné à quel point les traces dont nous disposons peuvent biaiser notre connaissance, à commencer par le fait que les armes destinées au combat, avant qu’elles soient faites de métal, ont pu s’évanouir sans laisser de traces ou nous parvenir sans pouvoir être identifiées comme telles. Sur ce sujet controversé, les écueils méthodologiques sont légion et il paraît difficile de soutenir fermement quelque position que ce soit sans les évoquer, de même que les débats qu’ils ont entraînés. Il existe en tout cas de sérieuses raisons de se méfier des apparences et de soupçonner que celles-ci tendent à pacifier rétrospectivement des sociétés de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, qui ont sans doute pu connaître des conflits qui dépassaient largement la simple violence interpersonnelle.Quoi qu’il en soit, et au-delà des éventuelles interrogations ou réserves que peut soulever telle ou telle contribution, par l’ampleur de sa perspective et la qualité des synthèses qu’il propose, ce vaste travail collectif est incontestablement destiné à rester une référence. Indispensable à l’historien ou au préhistorien professionnel ou en devenir, il sera plus généralement utile à tout esprit curieux, souhaitant se familiariser avec l’état actuel des connaissances sur les multiples sentiers qu’a empruntés l’aventure humaine.


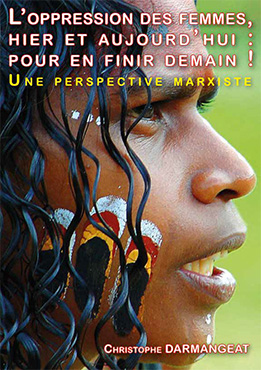

Aucun commentaire