Un trésor ethnographique philippin
 |
| Carte ethnographique des Philippines Les Tagalog correspondent au nombre 59, Les Visayans au nombre 12 |
Il est des régions du monde sur lesquelles, pour des raisons historiques, on dispose de peu de matériel ethnographique. C'est le cas de certaines parties de l'Asie du Sud-est, telles les Philippines, traditionnellement non étatisées et sans relations étroites avec des sociétés à écritures, et qui furent brisées dès l'arrivée des colonisateurs occidentaux. Aussi est-ce un petit événement lorsqu'un document contenant de précieuses informations, et jusque là confidentiel, devient accessible au grand public. J'ajoute qu'on ressent une émotion particulière en parcourant des descriptions qui portent sur des endroits où l'on s'est rendu personnellement (je suis allé deux fois aux Philippines, très précisément dans les deux lieux dont il va être question dans ce billet, non pour y étudier l'ethnologie, mais pour y observer des merveilles sous-marines).
Le document en question est connu sous le nom de Codex de Boxer, du nom du professeur, spécialiste de la région, qui en avait fait l'acquisition il y a quelques décennies. Ce codex est un recueil de textes, la plupart anonymes, rédigés en espagnol, et rassemblés autour de 1590. À ces textes sont jointes plusieurs dizaines de très belles illustrations possiblement réalisées par un artiste chinois, qui ajoutent encore à l'intérêt du document. L'ouvrage a été numérisé, et on peut le consulter ou le télécharger à cette adresse (attention, le pdf pèse tout de même la bagatelle de 330 Mo).
Mais le castillan manuscrit du XVIe siècle restant accessible seulement à une poignée de spécialistes (dont je ne fais évidemment pas partie !) les éditions Brill ont eu la bonne idée de publier une transcription et une traduction anglaise du Codex, réalisées par George Bryan Souza – le livre reproduit aussi, bien évidemment, les illustrations. Comme il est de tradition chez cet éditeur, l'ouvrage est hors de prix. Heureusement, les bibliothèques existent, et je suis donc allé en dévorer le contenu avec gourmandise ; je n'ai pas été déçu.
Le livre compte une demi-douzaine de chapitres sur les tribus des Philippines proprement dites, auxquels s'ajoutent des textes sur les habitants de l'île de Guam, sur des États de ce qui est aujourd'hui l'Indonésie, ou encore sur Brunei ou le Japon. Les témoignages sont d'un intérêt très inégal – certains, très courts, ne rassemblent que quelques impressions superficielles. Mais d'autres sont fort détaillés et traduisent la bonne connaissance que leur auteur pouvait avoir avec les sociétés décrites.
C'est en particulier le cas pour les tribus des Visayas (les îles centrales de l'archipel, dont les deux principales sont Cebu et Leyte), et pour les Tagalog (la région de l'actuelle Manille, au sud de la grande île septentrionale de Luzon), auxquels quatre chapitres – dont deux détaillés – sont consacrés. Les Tagalog semblent avoir eu des coutumes et des institutions très voisines de celles de Visayans, si l'on excepte quelques écarts dus notamment au fait que les premiers, contrairement aux seconds, avaient été un peu islamisés suite à leurs relations avec les commerçants musulmans de Brunei. Un des auteurs écrit ainsi que dans toute la région, si les langues, les vêtements et autres traits culturels sont très divers, les rituels et les cérémonies, eux, sont tout à fait semblables.
Premier point bien établi : ces sociétés ne sont pas étatiques. Ils n'ont « ni roi ni autorité » (344). Ils n'ont pas non plus d'appareil judiciaire (les gens, du moins s'ils sont libres, se font justice eux-mêmes), ni de temples. Les tagalogs disposent néanmoins de spécialistes religieux « bien payés » (non par l'impôt, évidemment, mais à l'acte), et qui paraissent avoir été avant tout des homosexuels habillés en femmes, qui épousaient d'autres hommes. Ce sont des sociétés fortement marquées par l'inégalité et par les différences de richesse – dans les milieux aisés, on y paye un prix de la fiancée âprement négocié, et partout, des compensations pour meurtre et de multiples amendes et pénalités. On y connaît une certaine division du travail, avec des menuisiers-charpentiers, des joailliers, ou encore des forgerons. Par ailleurs, ces sociétés sont marquées par des hostilités permanentes, que ce soit au sein des villages, pour des feuds, ou pour des affrontements plus larges, entre villages entiers.
Deux statuts sociaux concentrent l'essentiel de l'attention des auteurs : les chefs et les esclaves.
L'esclavage
 |
| Un couple de libres dans les Visayas On notera leurs abondants tatouages (extrait du codex de Boxer) |
Les esclaves des Visayans possèdent trois statuts différents. Les jeunes sont hayoheyes, c'est-à-dire domestiques, et vivent sous le toit de leur maître. Une fois mariés, ils deviennent tuhoyes : ils partent s'installer dans leur propre foyer et, tant qu'ils n’ont pas d’enfants, continuent de servir 5 jours par semaine. À mesure des naissances, ce temps de service se réduit, éventuellement jusqu’à disparaître s'ils se retrouvent en charge d'une famille nombreuse. Une troisième catégorie d'esclaves porte le nom de horohanes. Selon le texte :
« Ils n'ont d'esclaves que le nom, car ils ne fournissent aucun service, excepté lorsque leurs maîtres partent en guerre, auquel cas ils sont embarqués comme rameurs. Généralement, leurs maîtres les invitent les chez eux lorsqu'ils donnent une fête et un banquet. Et lorsque ces esclaves meurent, leurs biens sont conservés par leurs maîtres, ce qui ne laisse rien à leur famille. Et s'ils ont des enfants, les enfants ne sont pas tenus de servir dans la maison des maîtres de leurs parents tant que ceux-ci sont vivants, mais dès que leurs parents meurent, ils doivent servir leurs maîtres en lieu et place de leurs parents, accomplissant le même type de travail. » (351)
Voici à présent la description des esclaves chez les Tagalog, si informative que je ne peux que la citer in extenso :
« Ceux qui leur obéissent [aux chefs] sont leurs esclaves, et ils sont forcés de les servir. Ils ne les servent pas dans leurs maisons, mais de temps à autre, lorsque le chef part en guerre, ils doivent porter ses armes et lui apporter de la nourriture depuis leurs domiciles. Et s'ils vont en mer, ils doivent servir comme rameurs. (p. 384)Tous les esclaves des chefs ont des devoirs. Ces esclaves sont appelés olipon namamahe, ce qui veut dire ‘un esclave qui subvient à ses besoins’. Ils ont de nombreux devoirs. Par exemple, chacun doit apporter une grande jarre de terre de quilang, une boisson faite de sucre de cane et qui est commune parmi eux. Ils apportent aussi de nombreux gantang de riz blanc. Il est d'autres esclaves qu'ils nomment tagalos ; certains d'entre eux sont appelés namamahe et d'autres gigilid namamahe, ce qui signifie ‘Indien qui possède sa propre maison’, et gigilid, ‘un Indien qui demeure et vit dans la maison de son maître, le servant jour et nuit. Le maître peut le vendre parce qu'aucun de ces esclaves qui vivent dans la maison de leur maître n'est marié – ce sont tous des célibataires. Et si un esclave masculin désire se marier, son maître ne l'empêche pas, et un tel esclave est appelé namamahe lorsqu'il se marie ; il vit à présent de manière indépendante. Et, aussi étrange que cela paraisse, les esclaves qui vivaient autrefois dans la maison de leur maître ont le droit de se marier ; pas un des esclaves masculins n'en est empêché. Les esclaves chasés doivent équiper le bateau de leur maître lorsqu'il part en mer et lui apporter sa nourriture. Et lorsque le chef tient un banquet obligatoire, par exemple lorsqu'il se marie, ou lorsqu'un de ses proches décède, ou si son bateau a coulé, ou s'il a été fait prisonnier, ou s'il a été malade – toutes ces choses exigent de grands banquets – l'esclave chasé doit apporter une grande jarre de terre de quilang, ou de vin, et autant de riz, et l'assister à ses banquets. Et si le maître n'a pas de maison, ces esclaves lui en construisent une à leurs propres frais. La seule chose que le maître fasse pour eux en récompense est de tenir un banquet lorsque les poteaux sont coupés, et un autre lorsqu'ils sont érigés. Et tous les Indiens de la ville y assistent. (...) Ils tiennent un autre banquet en posant le toit de la maison, auquel assistent tous les esclaves qui appartiennent au maître, et ils y boivent à leurs propres frais. Et ils coupent le bois pour lui et font tout le reste de ce qui est nécessaire pour construire la maison, et en échange ils ne reçoivent rien d'autre que de la nourriture.Chaque année, ces esclaves chasés versent au maître un tribut annuel (sic) de 100 gantang de riz non décortiqué (...) Et ils doivent donner au maître un peu de tout ce qu'ils plantent. Et s'ils font du quilang ils lui en donnent une grande jarre de terre ; s'ils vont chasser le daim, ils donnent une cuisse au maître. Et si leur maître suit la loi de Mahomet, et qu'ils trouvent le daim avant que les chiens ne le tuent, ils lui tranchent la gorge avant de le transpercer de leur lance (...). Et lorsqu'un de ces esclaves meurt, ses obligations sont les suivantes : s'il a des enfants, le chef prend l'un d'eux pour le servir dans sa maison, et ceux-ci sont les gigilid (...) Et si un Indien libre épouse une esclave, ou si un esclave épouse une femme libre, et qu'ils ont des enfants, les enfants sont divisés de la manière suivante : le premier-né est libre, et le suivant est fait esclave, et on conserve cet ordre en les séparant du côté de la mère comme de celui du père. Des enfants faits esclaves, le maître ne peut en prendre plus d'un dans sa maison, et la même restriction s'applique si le père et la mère sont tous deux esclaves. Et s'ils ont de nombreux enfants, au maximum deux sont pris pour servir dans la maison du maître ; et s'il en prend davantage, ils considèrent cela comme une offense et un acte de tyrannie. Et après qu'ils ont quitté la maison du maître afin de se marier après avoir servi dans la maison du maître (sic), ils ne le servent plus jamais, sauf pour accomplir les devoirs du namamahe. C'est-à-dire qu'à moins que le maître ne les force, ils considèrent comme une offense et un acte de tyrannie s'il les oblige à retourner dans sa maison après leur avoir donné la permission de partir. Et ces esclaves ont hérité ces coutumes de leurs ancêtres. » (384-388)
La première question qui vient à l'esprit est de se demander s'il s'agit bel et bien d'esclaves : sur plusieurs aspects, en effet, le pouvoir des maîtres ne semble pas absolu, et la coutume paraît prévaloir sur leurs caprices (même si on aimerait savoir quels recours pouvaient avoir des esclaves dont le maître commettait un « acte de tyrannie »). Cette description illustre en tout cas qu'en matière de statuts juridiques, il existe une infinité de combinaisons et de dégradés, et qu'il est difficile de trouver des catégories (telles que esclave, ou serf) qui rendent convenablement compte de l'inventivité des sociétés. Quoi qu'il en soit dans ce cas précis, esclavage ou non, il s'agissait en tout cas de formes très lourdes de dépendance. Le fait est confirmé par la pratique des morts d'accompagnement, magistralement analysée par A. Testart – s'il avait eu cette source à disposition, nul doute qu'il l'aurait ajoutée à son inventaire. On lit ainsi :
Chez les Visayans, en cas de décès d'un chef, les cérémonies funéraires durent deux mois :« À la mort d'un Tagalog, on place un de ses esclaves avec lui dans la tombe ; on l'enterre vivant sous le cercueil, près de la tête du défunt pour qu'il puisse le servir dans l'autre monde. » (365)
« Ils mettent à mort certains des esclaves du chef, les faisant mourir de la même manière que leur maître. (...) ils disent que c'est nécessaire pour que les esclaves (...) puissent aller dans l'autre monde servir leurs maîtres et préparer leur nourriture. (...) En règle générale, ils enterrent leurs chefs les plus puissants dans des bateaux appelés barangay, avec nombre de ses esclaves vivants et de grandes quantités de nourriture, de vêtements et de bijoux, disant que les esclaves le serviront ainsi qu'ils le faisaient à chaque fois qu'il voyageait par mer. » (353)
Un autre témoignage estime ce nombre à soixante, ce qui illustre l'ampleur du phénomène et la puissance sociale de ces personnages. On aimerait évidemment savoir de quelle catégorie relevaient ces esclaves. La logique voudrait qu'il s'agisse de ceux « du premier cercle » : les esclaves domestiques, les plus dépendants. Mais, faute d'information, il ne peut s'agir que d'une probabilité.
Les « chefs » : la marche à l'État ?
 |
| Aristocrates tagalog (extrait du codex de Boxer) |
À l'autre pôle de la société, maîtres de la plupart (sinon de la totalité ?) des esclaves, se trouvent donc ces « chefs » dont le codex ne nous laisse guère deviner quelles étaient leurs prérogatives exactes. Là encore, le vocabulaire est glissant, la science sociale n'ayant jamais fait l'effort de forger une liste de termes capables de cerner de près les différentes formes d'aristocratie.
L'absence de toute information en ce sens semble accréditer l'idée que ces chefs ne doivent leur puissance à nulle position formelle : on ne trouve aucune mention de fonctions, ni de grades, ni de rangs officiellement consacrés. Les chefs paraissent ainsi être des puissants du seul fait qu'ils sont riches. En ce sens, les sociétés que le codex laisse entrevoir paraissent illustrer à merveille la catégorie des « ploutocraties ostentatoires » proposée par A. Testart – les incessants banquets publics auxquels sont tenus les chefs en sont un élément saisissant. On compte un chef ou deux par village dans les Visayas, trois ou quatre chez les Tagalog. Un chroniqueur note que « les habitants, pour beaucoup, sont leurs esclaves, les autres sont leurs parents. » (344) et que ceux-là ne leur doivent pas de tribut.
Mais ces chefs semblent également détenir un certain nombre de pouvoirs sur lesquels plane une certain flou, en particulier ceux relatifs à la mise en esclavage.
Celle-ci, dans un certain nombre de cas, a pour seule origine la misère : dans les périodes de disette, les parents vendent leurs enfants, et les parents se vendent les uns les autres. Il suffit de ne pouvoir honorer un paiement, qu'il s'agisse des intérêts d'un emprunt ou d'une amende contractée, par exemple, suite un adultère, pour perdre sa liberté (352, 388).
De ce point de vue, les chefs semblent être logés à la même enseigne que tout le monde : ils ne peuvent réduire en esclavage que ceux qui ont une dette envers eux. Cependant, quelques affirmations laissent entrevoir une puissance sociale qui déborde largement ce cadre. C'est, pour commencer, la manipulation des règles lorsque la victime n'a pas les moyens de se défendre ; ainsi, chez les Tagalog (où un témoin affirme pourtant que les empiétements des chefs sont moindres que dans les Visayas) :
« Quand quelqu'un devient orphelin sans personne pour venir à sa défense, les chefs le réduisent en esclavage au prétexte que son grand-père leur devait quelque chose, même si ce n'était pas le cas. De même, s'il n'a ni père, ni mère, ni oncle paternel, ni un autre parent pour le protéger, le chef le traite comme s'il était un esclave acheté. » (381).
Dans les Visayas, un degré supplémentaire semble être franchi :
« Les chefs agissent à leur guise et personne n'arrête leur bras : ils réduisent quiconque en esclavage pour la moindre infraction, et ils affranchissent qui ils veulent avec la même facilité sans en répondre à quiconque » (347)
Parmi les innombrables infractions en question, « la première est la simple offense commise par une personne qui croise la route d'un chef, si elle manque de s'incliner suffisamment vite. » De même, « si une personne pose le pied dans l'eau du champ qui appartient au chef ». Le même témoin ajoute : « Ils ne possèdent aucune loi ou coutume permettant de mettre les gens à mort, pour quelque crime que ce soit. Ils peuvent seulement en faire des esclaves. » (352)
En fait, la lecture d'une synthèse comme celle écrite par W. H. Scott (Barangay, Ateleo de Maila University Press, 1994) donne de la classe dirigeante une image assez sérieusement différente de celle du codex.
Pour commencer, l'appartenance au groupe des « chefs » (nommés datos ou datu par les Visayans – le mot désignait à la fois le poste de chef et, plus globalement, l'appartenance à l'aristocratie) était un statut de naissance : les datu étaient les descendants en ligne directe des datu des générations précédentes, si bien que les membres de ce groupe s'efforçaient d'épouser des individus du même statut qu'eux. Les enfants de leurs secondes épouses possédaient eux aussi un statut nommé, un peu inférieur ; de même pour les enfants d'éventuelles unions avec des gens du commun.
Parmi les datu assumant effectivement une charge, certains apparaissaient comme proéminents, des primus inter pares, sans réel pouvoir sur les datu de second plan. Les « rois » qu'avaient cru identifier certains espagnols n'étaient donc que des chefs plus puissants, mais qui ne se trouvaient nullement à la tête d'une organisation hiérarchique et formalisée.
Dans l'exercice de leur fonction, les datu semblent avoir été assistés d'une équipe fournie : conseiller principal, majordome, intendant gérant les tributs et les esclaves du domaine, homme d'arme dont le domicile servait de prison – tous issus du même lignage que le leur. Les datu bénéficiaient également de droits étendus sur les terres communales. Ils ne formaient pas pour autant une classe libérée du travail productif ; ils étaient spécialisés dans la chasse, mais aussi le travail du métal et (surtout ?) les expéditions commerciales maritimes, tandis que leurs épouses tissaient elles-mêmes les belles étoffes dont elles étaient vêtues.
Quant à la classe des hommes libres, W. H. Scott laisse entendre qu'elle était relativement étroite et privilégiée et donc, qu'elle se traduit mal par l'expression « gens du commun ». Certains d'entre eux, libres de changer de datu, leur versaient un tribut (une information qui contredit le codex). D'autres, plus fidèlement attachés à sa personne, semblaient posséder une position qui évoque celle du chevalier ayant fait allégeance à un suzerain. Ils formaient manifestement une suite militaire, assistant le datu dans certaines occasions publiques et à la bataille et percevant une part du butin. Ils étaient frappés d'une restriction étonnante, à savoir qu'ils ne pouvaient transmettre leur héritage à leur progéniture sans l'approbation du datu. Celui-ci disposait là d'une arme redoutable pour sanctionner un suivant trop peu fidèle.
La classe des esclaves, manifestement la principale sur le plan numérique, recouvrait une diversité de statuts plus grande que celle exprimée dans le codex. W. H. Scott fournit d'abondants détails sur ce que chaque type d'esclave devait au maître, et sur les règles qui présidaient à la transmission du statut servile.
En guise de conclusion
Les sociétés philippines précoloniales semblent avoir connu une profusion de statuts juridiques, dont le principe organisateur était manifestement celui de la dette. Les esclaves (ou dépendants) l'étaient parce qu'ils étaient endettés (les prisonniers de guerre, ayant été à la merci de leur ravisseur, lui devaient en quelque sorte la vie). À en croire W. H. Scott, leurs obligations étaient évaluées selon mille raffinements, en fonction du degré de dépendance dans lequel la dette qui motivait leur statut les avait placés.
Je ne discuterai pas de la difficile question de savoir si cette société non étatique connaissait déjà des classe sociales ou non ; tout est affaire de critère, et autant je vois les nombreux inconvénients à la réponse d'Alain Testart (le passage à un certain type de propriété foncière), autant je ne sais pas par quoi il conviendrait de le remplacer. Spontanément, j'ai tout de même du mal à imaginer qu'une société telle que celle décrite dans ce billet, où la majorité de la population se trouve de fait comme de droit dans une très forte dépendance à l'égard des puissants, ne soit pas une société de classe, ou du moins une société où l'on est extrêmement proche d'avoir des classes achevées, et ce quel que soit le régime foncier en vigueur.
Quoi qu'il en soit, il me semble que les Philippines précoloniales illustrent la porosité des catégories politiques selon lesquelles A. Testart distinguait les sociétés à richesse, mais dépourvue d'États. Cet auteur opposait en effet les « ploutocraties ostentatoires », dépourvues d'organisation politique formelle, et dans lesquelles les riches assumaient spontanément les fonctions de direction sociale, des « semi-États » où des conseils ou des lignages structuraient les relations d'autorité entre êtres humains. Or, on se trouve là manifestement devant une société qui emprunte aux deux catégories (ou, à tout le moins, qui infléchit sérieusement la première) ; les datu tirent certes leur puissance de leur richesse, en biens précieux servant aux paiements comme en esclaves. Mais ne sont datu que les membres d'un certain lignage. Le groupe dirigeant n'est pas seulement celui des gens riches : c'est aussi, et seulement, celui des gens biens nés.


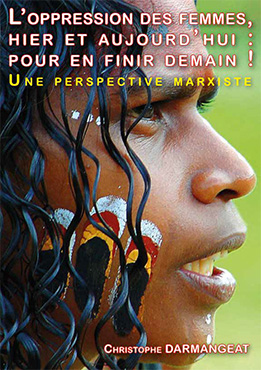

Aucun commentaire