La guerre en Australie aborigène : une étude de cas
 |
| Un homme Tiwi |
Les conflits armés qui rythmaient l'existence des sociétés aborigènes d'Australie, sur lesquels je suis intervenu à plusieurs reprises dans ce blog, soulèvent évidemment bien des questions. Un premier aspect, assez largement admis, est que leur niveau de létalité était significativement supérieur sur ce continent à ce qu'il était chez d'autres chasseurs-cueilleurs. Mes propres données, qui ne répertorient que les conflits à caractère collectif, sont très loin d'être suffisantes pour établir des statistiques. Mais, j'y reviendrai à la fin de ce billet, certains ethnologues ont proposé de telles estimations pour des populations qu'ils avaient étudiées. Le second point, distinct du précédent, concerne la forme des affrontements, et en particulier l'existence de conflits à caractère collectif (ce qu'on pourrait appeler d'authentiques guerres, bien que je ne tienne pas à m'enliser ici dans un difficile débat terminologique).
Or, pour l'Australie, nous avons la chance de disposer de deux ethnographies très informées sur deux tribus vivant dans des zones relativement proches et qui, du point de vue des conflits armés, présentent à la fois des points communs et des oppositions très instructives : je veux parler des Tiwi de l'île de Bathurst et les Murngin, un nom générique appliqué à un ensemble de populations du nord-est de la Terre d'Arnhem. Durant l'entre-deux guerres, les premiers ont été étudiés par C. Hart (relayé ensuite par A. Pilling), et les seconds par L. Warner.
Commençons donc par les points communs. Sans revenir sur les caractères généraux des sociétés aborigènes (absence d'inégalités de richesse, de paiements en biens, de structures politiques, etc.), Tiwi et Murngin se caractérisaient par un haut degré de violence interpersonnelle. Ce sont d'ailleurs les seules tribus australiennes pour lesquelles on dispose d'un relevé précis des différents épisodes sanglants : Pilling les consigne méthodiquement dans sa thèse, donnant à chaque fois les noms et les circonstances, et Warner fait peu ou prou de même dans son célèbre article/chapitre sur la guerre. Dans un cas comme dans l'autre, on réparait les torts par l'usage de la violence physique selon différentes modalités. Les plus communes étaient ce qu'on a coutume d'appeler l'ordalie (et que Hart et Pilling, curieusement, nomment le « duel ») et l'expédition nocturne pour exécuter le fautif réel ou présumé. Chez les Murngin, ces expéditions, selon les variantes, s'appelaient maringo et narrup. Chez les Tiwi, c'étaient les kwampi, où les lances utilisées (sans propulseurs) et qualifiées de « cérémonielles » dans la littérature, se distinguent par l'ostentation de leur décor et de leurs barbelures. Une autre procédure commune était celle de la bataille régulée, où les deux troupes qui s'affrontaient cessaient le combat à la première blessure sérieuse.
La guerre présente ici et absente là
Mais à partir de cette base commune, les deux sociétés divergeaient. Du côté des Murngin, certains conflits entraînaient un nombre de victimes très important eu égard aux effectifs impliqués (que ce soit ceux des combattants, ou ceux de la population en général). Faut-il le rappeler, dans ces sociétés, le fait militaire n'est pas le monopole d'une minorité spécialisée : tout homme adulte doit défendre ses droits par les armes. Les Murngin pratiquent donc quelquefois des expéditions maringo particulièrement létales, où une fois le camp ennemi cerné, plusieurs individus sont frappés. Plus encore, ils connaissent le gaingar, une forme de bataille ouverte dans laquelle on cherche à infliger des pertes maximales. Dans ces affrontements, on trouve de manière indubitable deux groupes qui se combattent en tant que tels. À moins de tordre le sens des mots, il est clair qu'on a bel et bien affaire à d'authentiques guerres.
Chez les Tiwi, en revanche, rien de tel. Non seulement l'équivalent du gaingar est inconnu, mais les batailles ouvertes régulées elles-mêmes possèdent une physionomie assez particulière. Hart et Pilling narrent en termes pittoresques l'une de ces oppositions :
 |
| Une sagaie dite cérémonielle, utilisée dans les feuds (kwampi) |
Après une nuit principalement consacrée par les deux camps à des visites individuelles et à renouer avec de vieilles connaissances, les deux armées se rencontrèrent le lendemain matin sur le champ de bataille, avec les 30 combattants Tiklauila-Rangwila alignés d'un côté de la clairière, et environ 60 guerriers locaux à l'autre bout. Immédiatement, ce fut le schéma familier du duel qui s'imposa. De chaque côté, un ancien commença à haranguer directement un individu du côté opposé. Lorsqu'il était à bout de souffle, un autre se mettait à énoncer ses griefs. Étant donné que chaque Mandimbula répliquait individuellement aux accusations portées contre lui, toute l'affaire en restait au niveau d'accusations mutuelles et de réponses entre des paires d'individus. Des deux côtés, les vieux hommes en colère tentaient de trouver une base pour justifier ou provoquer l'attaque générale d'un groupe par l'autre, mais ils n'y parvenaient pas en raison de la spécificité des accusations (...) De sorte que quand les sagaies commencèrent à partir, elles étaient jetées par des individus sur d'autres individus, en raison de différends individuels. (...)Aussitôt que quelqu'un était blessé, même une vieille femme apparemment sans aucune espèce d'importance, le combat cessait jusqu'à ce que les implications du nouvel incident soient établies par les deux camps. Car cette vieille femme n'était jamais tout-à-fait sans importance ; elle était la mère d'un individu, la femme d'un deuxième, la sœur d'un troisième, de sorte que la question de savoir qui avait lancé la sagaie qui l'avait blessée donnait lieu à une nouvelle série de querelles, qui devaient être intégrées à toutes les anciennes. Un homme qui s'était tenu assis, vaquant à ses propres affaires sans avoir de démêlés avec quiconque, bondissait soudain au milieu de la scène en annonçant que la vieille dame blessée était sa mère et que, par conséquent, il voulait la peau du rat qui l'avait molestée, et une nouvelle dispute commençait alors.De la même manière, si la personne blessée par la première volée de sagaies était un homme âgé, les conflits se voyaient orientés vers une nouvelle direction car ses parents, présents dans les deux camps, se sentaient obligés de le soutenir et de venger sa blessure, (...). Il n'était pas rare que les raisons originelles de la dispute, celles qui avaient motivé au départ la rencontre des armées, soient oubliées et se soient dissoutes dans les nouveaux griefs et combats qui avaient surgi sur le champ de bataille. (...)Ainsi, les batailles Tiwi (...) duraient généralement une journée entière, durant laquelle environ les deux tiers du temps étaient employés à des invectives et à des insultes mutuelles entre des personnages centraux et périphériques qui changeaient constamment. Le tiers du temps restant était divisé entre des duels où l'on se lançait des sagaies jusqu'à ce qu'il y ait un blessé, et de brèves éruptions de jets de projectiles plus généralisés, qui impliquaient peut-être une douzaine d'hommes à la fois, et qui prenaient fin quand quelqu'un était touché, même un spectateur.
Avec leur humour distancié coutumier, Hart et Pilling décrivent ensuite la manière dont une telle journée avait fait naître autant de ressentiments qu'elle n'avait résolu de problèmes, chacun soupesant et ruminant les blessures, les injures, et même le fait que tel ou tel avait été trop empressé (ou pas assez) à prendre parti.
Une explication simple ?
Comment expliquer, sur le fond, cette incapacité des combats Tiwi à devenir d'authentiques guerres et, même lorsqu'ils impliquaient des collectivités, à demeurer une somme de combats individuels qui ne s'agrégeaient jamais véritablement ? La réponse paraît simple, et elle est donnée par les auteurs eux-mêmes :
Les bandes ne représentaient pas des entités politiques fermes et, par conséquent, ne pouvaient pas s'affronter en tant que bandes. (...) La soi-disant expédition de guerre d'une bande contre une autre se révélait n'être qu'une lâche agglomération d'individus, chacun défendant sa propre cause, qui trouvaient plus pratique et plus sûr de voyager ensemble à travers le territoire d'une autre bande et de défendre leurs cas individuels le même jour au même endroit. Les relations interpersonnelles, chez les Tiwi, étaient avant tout des relations de parenté entre membres des différentes bandes, les loyautés territoriales étaient mouvantes, temporaires et nécessairement subordonnées aux loyautés de parenté. Par conséquent, parmi les Tiwi, il n'existait ni ne pouvait exister de guerre, dans le sens de batailles féroces entre groupes constitués selon des loyautés territoriales.
Passons sur la dernière précision, qui restreint bien inutilement la définition de la guerre – les groupes qu'elle oppose peuvent fort bien être constitués sur une loyauté autre que territoriale, à commencer, justement, par la parenté. Le point décisif est que les Tiwi ne possèdent pas de groupes que les anglo-saxons appellent « en corps » du point de vue de l'exercice de la violence. Du côté des Murngin, en revanche, cette existence, même si elle semble encore ténue, ne fait cependant pas débat. Warner écrit ainsi :
Une activité importante du clan est la guerre, le clan étant le groupe qui mène la guerre. (...) En tant que groupe, un clan n'entre que rarement en guerre contre un autre, mais il entretient généralement un feud perpétuel avec certains autres, provoquant de temps à autre des embuscades dans lesquelles un homme ou deux sont tués.
 |
| Une image du film Ten canoes, qui se déroule chez les Murngin |
On pourrait donc se dire que les choses simples s'expliquent simplement : l'existence (chez les Murngin) ou l'absence (chez les Tiwis) de conflits opposant des groupes est simplement liée à la présence ou à l'absence de groupes en corps sur le plan politico-juridique. Du côté des Tiwi, la situation est toutefois beaucoup moins claire qu'il n'y paraît au premier abord. Si l'ethnographie de Hart et de Pilling ne mentionne comme groupes sociaux que ces « bandes », formées sur des bases territoriales, et donc n'agissant jamais en tant que telles dans le domaine politico-judiciaire, la thèse de Pilling, rédigée quelques années plus tôt, donnait en revanche une tout autre image. L'auteur commençait par inventorier l'ensemble des structures – fort nombreuses – qui organisaient la société tiwi. Parmi celles-ci se trouvait le clan matrilinéaire, auquel il attribue la caractéristique d'être, traditionnellement, « une unité sociale disposant du droit d'imposer des sanctions ». Plus encore, depuis le contact, ce rôle juridique du clan s'était selon lui renforcé. Pilling détaillait ainsi comment les Aborigènes avaient constamment à l'esprit le nombre de combattants potentiels de chaque clan, ou comment se forgeaient des alliances entre clans (dénommées « super-clans »). Il remarque même que les clans qui se combattent sont toujours ceux d'une même moitié, car ce sont ceux qui sont en rivalité pour les épouses, un constat qui correspond très exactement à celui établi par Warner un peu plus loin sur le continent. Or, dans le livre co-écrit avec Hart, les clans ont littéralement disparu : il n'en est fait aucune mention. Seule la bande est évoquée, comme un groupe auquel tout Tiwi s'identifiait et vouait sa loyauté.
J'avoue ne pas être capable de m'expliquer une telle divergence entre deux écrits du même auteur, à si peu d'intervalle. Une rapide recherche semble confirmer l'existence des clans ; dès lors, l'explication la plus évidente serait que Pilling s'était convaincu entre-temps que ceux-ci n'avaient en réalité pas de rôle politico-judiciaire, et qu'ils pouvaient donc être négligés de ce point de vue. Il faut ajouter que le livre coécrit avec Hart ne consacre que quelques pages aux questions de la violence légitime : l'essentiel de son propos porte sur les questions de stratégies matrimoniales.
Une remarque finale
Si les Murngin et les Tiwi s'opposent donc du point de vue de la présence de cette forme particulière d'exercice de la violence qu'est la guerre, il ne faut pas en déduire trop hâtivement que la société Murngin aurait nécessairement été plus violente que la société Tiwi. Un tel raisonnement serait lourdement grevé d'un biais ethnocentrique : la guerre étant, dans les sociétés étatiques, la forme du déploiement le plus large de la violence, on a tendance à en conclure qu'une société sans guerre est nécessairement moins violente d'une société à guerres. Mais c'est oublier qu'on ne peut raisonner toutes choses égales par ailleurs, et que si l'État mène des guerres « publiques », il a également pour effet d'empêcher les guerres privées, c'est-à-dire les feuds. Une société peut donc ignorer la guerre (publique) tout en connaissant un niveau très élevé de guerres privées : si personne ne perdra la vie dans de vastes affrontements collectifs, beaucoup peuvent perdre la leur dans les incessants meurtres et contre-meurtres.
En l'occurrence, pour autant qu'on puisse en juger, le niveau général d'homicides n'était pas significativement différent dans les deux sociétés. Les Tiwi ont toujours stupéfait les pacifistes primitifs, convaincus que la violence devrait nécessairement se situer à un niveau très faible chez des chasseurs-cueilleurs dépourvus de richesses matérielles, de rapports d'exploitation économique... et de guerres. Pilling expliquait ainsi durant le célèbre congrès Man, the Hunter qu'en une décennie (1893-1903) au moins 16 hommes entre 25 et 45 ans avaient été victimes d'homicides volontaires, soit un dixième des effectifs masculins de cette tranche d'âge – Pilling reliait cette surmortalité masculine au très haut degré de polygynie constaté chez ce peuple, expliquant que celui-ci n'aurait pas été possible sans celle-là. Chez les Murngin, Warner estimait pour sa part qu'en l'espace de 20 ans, environ 200 personnes (surtout des hommes) avaient péri par les armes, sur une population totale d'environ 3000 individus. Ce dernier chiffre est très éclairant : imaginons ce que serait la vie dans un de nos chefs-lieu de canton où il y aurait, en moyenne, 10 morts violentes par an. De tels chiffres n'empêchent nullement une société de vivre et de se perpétuer, mais on comprend aisément qu'ils témoignent d'un climat d'insécurité permanente.


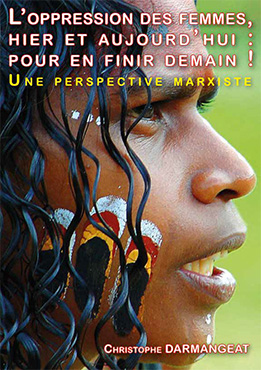

Aucun commentaire