Note de lecture : Âge de pierre, âge d'abondance (Marshall Sahlins)
Avertissement : commencé comme un simple compte-rendu de lecture, ce billet a pris une certaine ampleur. En l'écrivant, je me suis rendu compte de la difficulté des questions qu'il soulève. En tout état de cause, les réponses qu'il contient doivent donc être considérées comme provisoires. Et qui sait, certaines commentaires m'aideront peut-être à y voir plus clair !
Ce livre, paru dans les années 1960, est sans aucun doute un des plus influents qui aient jamais été écrits en ethnologie. Plus souvent cité que véritablement lu, il s'inscrit dans l'abondante littérature qui entendait d'une manière ou d'une autre réhabiliter les sociétés de chasse-cueillette. Il possédait toutefois deux grandes originalités. La première était la notoriété et la qualification de son auteur, un anthropologue de renommée mondiale. La seconde était sa thématique, puisque ce n'était pas pour une fois sur le plan moral, ou spirituel, que les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient censées s'avérer supérieures aux types sociaux ultérieurs, mais sur le terrain même où leur infériorité semblait la plus évidente : celui de la performance économique.
En réalité, Âge de pierre, âge d'abondance rassemble six essais d'inspiration assez dissemblables, dont seul le premier expose et argumente la thèse qui l'a rendu célèbre. Les deuxième et troisième essais traitent du « mode de production domestique », censé caractériser les premières sociétés de cultivateurs. Le quatrième discute du célèbre exposé de M.Mauss au sujet du hau et de l'obligation de rendre un don, tandis que les deux derniers discutent de l'échange dans les sociétés primitives. Le présent billet sacrifiera néanmoins à la tradition : il ne discutera que du premier de ces chapitres, considéré comme la contribution majeure de l'ouvrage.
La démonstration de l'auteur peut être résumée en quatre points :
Sur l'Australie, M. Sahlins remarque fort justement que les zones les plus prodigues, celles qui assuraient à leurs habitants le meilleur niveau de vie, ont précisément été celles où l'occupation occidentale, et l'extermination des Aborigènes, ont été les plus précoces, et pour lesquelles les études précises font défaut. La littérature du xixe siècle, sous les plumes de G. Grey, E.M. Curr, C. Hodgkinson ou J. Eyre, est ainsi convoquée pour souligner l'aisance alimentaire des populations concernées. Cette impression semble peu contestable, et d'autres témoignages la corroborent, tels A. Howitt, qui écrit à propos des Kurnai (qui vivaient 200 km à l'est de Melbourne) :
Si l'on peut donc, moyennant quelques réserves, admettre pour l'essentiel les jugements de M. Sahlins en ce qui concerne certaines zones de l'Australie, les choses sont assez différentes avec son deuxième exemple principal, celui des Bushmen.
À l'appui de leur supposée opulence alimentaire est invoquée l'autorité de Richard B. Lee, qui affirme :
Parmi les autres cas mentionnés par M. Sahlins, se trouvent les Montagnais, une population d'Indiens vivant dans la péninsule du Labrador. Là encore, le texte ethnographique est utilisé d'une manière fort orientée. De ce qu'écrit P. Le Jeune, un jésuite qui vécut parmi eux au xviiie siècle, Sahlins conclut à l'abondance de nourriture :
Pourtant, selon les citations de P. Le Jeune choisies par M. Sahlins lui-même, cette satisfaction est on ne peut plus aléatoire, comme on peut en juger (les soulignés sont les miens) :
Certes, M. Sahlins « n'entend pas nier que certains chasseurs sont parfois en difficulté » (p. 78) mais cette remarque n'est rien de plus qu'une révérence polie — on remarquera comment, à propos des Bushmen, il commence par concéder que leur « abondance » ne concerne pas l'alimentation (p. 47-48) avant de s'employer à démontrer l'inverse (p. 61-63). M. Sahlins remplace ainsi une caricature par une autre. À l'image, incontestablement fausse, de chasseurs-cueilleurs uniformément hâves, constamment en situation de survie précaire et tenaillés par la faim, il oppose celle, tout aussi peu réaliste, de populations, même dans les environnements les plus hostiles, à l'abri de tout stress alimentaire notable.
Ce chiffrage s'appuie sur des éléments assez peu nombreux, l'ethnologie s'étant globalement peu intéressée aux questions économiques, encore moins pour produire des données quantifiées. Les deux documents dont dispose M. Sahlins (et qui donnent des résultats convergents) sont une étude menée en 1948 dans le nord-ouest de l'Australie, et les chiffres fournis par R. B. Lee sur les Bushmen. Moins rigoureusement déterminées, mais encore plus frappantes, sont les données reprises de J. Woodburn à propos de Hadza de Tanzanie, qui, « globalement sur l'année [consacrent] probablement en moyenne moins de deux heures par jour à se procurer de la nourriture. » (cité p. 67).
Les conditions de l'étude australienne appellent plusieurs remarques :
D'autres recherches plaident d'ailleurs dans un sens assez différent. K. Hawkes et J.F. O'Connell 11 estimaient ainsi que le temps de travail chez les Alyawara d'Australie centrale oscillait entre quatre et dix heures par jour, un chiffre de 70 heures hebdomadaires pour les femmes n'étant pas rare. On était très loin des estimations de R.B. Lee ; la différence s'expliquait aisément par le fait que ce dernier ne comptabilisait dans le temps de travail que la recherche de nourriture proprement dite. En y ajoutant le temps passé à traiter et préparer la nourriture ainsi récoltée, on retrouvait les ordres de grandeur proposés par K. Hawkes et J.F. O'Connell.
Mais la question est peut-être moins de savoir combien de temps les chasseurs-cueilleurs passent à s'approvisionner, que d'interpréter correctement le temps de loisir dont ils disposent. Sahlins assume en effet que ce loisir est un signe de prospérité : les besoins essentiels étant assurés, ces peuples pourraient ainsi se consacrer à leur aise aux conversations, aux visites ou à dormir.
On admet d'ailleurs généralement que ces sociétés ne recherchent pas particulièrement l'augmentation du produit. Une augmentation de la productivité s'y traduit bien moins volontiers par une augmentation de la production que par une réduction du temps de travail ; on cite ainsi souvent le témoignage de L. Sharp à propos des Yir Yiront du Cap York :
Mais ce supposé renoncement volontaire des chasseurs-cueilleurs pour les biens de ce monde se heurte à un autre constat très largement partagé par les voyageurs et les ethnologues : les chasseurs-cueilleurs des cinq continents, dès qu'ils en avaient l'opportunité, n'étaient pas moins avides que nous des bienfaits de la civilisation matérielle. Ainsi que l'écrit un anthropologue :
Ainsi en va-t-il du concept central d' « abondance » (associé à celui, tout aussi central, de « rareté »). M. Sahlins critique « le sens commun, [pour lequel] une société d'abondance est une société où tous les besoins matériels des gens sont aisément satisfaits. » (p. 37), évoquant une « voie Zen », où « les besoins matériels de l'homme sont finis et peu nombreux, et les moyens techniques invariables, bien que, pour l'essentiel, appropriés à ces besoins. » (p. 38).
On doit donc comprendre de ces phrases que l'abondance, la rareté et les besoins ne sont pas des données objectives, qui se rapportent à des grandeurs indépendantes de l'esprit humain (tels que les besoins caloriques, par exemple) : tout au contraire, c'est la société qui les fixe à sa guise, créant ainsi abondance ou rareté. On ne sera donc pas surpris de lire que la société industrielle, avec son progrès technique inouï, est en réalité marquée par la plus grande pénurie de l'histoire :
Mais M. Sahlins croit si peu lui-même à la possibilité de définir l'abondance sur des bases aussi subjectives, qu'il réintroduit par la fenêtre ce qu'il avait bruyamment chassé par la porte, et qu'il tente donc de montrer que les chasseurs sont en réalité fort bien nourris. On a vu les limites de l'exercice ; on pourrait ajouter qu'il faut singulièrement tordre le sens des mots pour qualifier d'abondance des sociétés où le taux de mortalité infantile est de l'ordre d'un tiers.
Tout ceci ouvre la voie à une autre interrogation : celle du passage à l'agriculture.
Si les chasseurs-cueilleurs, affirme M. Sahlins, assuraient leur approvisionnement de manière aussi satisfaisante, et si l'agriculture n'a eu pour effet que d'augmenter le temps de travail tout en diminuant la ration alimentaire individuelle, il ne faut guère s'étonner que certains peuples aient préféré refuser ce prétendu progrès. Le stockage lui-même (rappelons que bien des chasseurs ont pratiqué le stockage bien avant de passer à l'agriculture) apparaît comme peu désirable, tant la sédentarité ne manque pas de provoquer une chute des rendements de la chasse.
Ces explications soulèvent bien davantage de problèmes qu'elles ne sont censées en résoudre. Car si l'on se doit d'expliquer pourquoi certains peuples — à supposer qu'ils étaient réellement en mesure de le faire — n'ont pas franchi les pas du stockage et de l'agriculture, bien plus nombreux sont ceux qui l'ont fait. Or, les théories de M. Sahlins nous laissent totalement désarmés pour comprendre ce mouvement général. « Pourquoi supposer que les chasseurs ayant refusé l'agriculture étaient des imbéciles, et qu'ils n'avaient pas d'excellentes raisons de le faire ? », interroge en substance M. Sahlins. Mais on peut facilement retourner la question, et demander pour quels obscurs motifs tant d'autres peuples ont pu se convaincre d'adopter des modifications économiques censées représenter une régression aussi générale.
Dans son désir de faire feu de tout bois, M. Sahlins en vient à des affirmations proprement étonnantes, comme lorsqu'il affirme que :
Notes
1 A. Howitt, « The Kurnai : ther customs in peace and war », in Kamilaroi and Kurnai, 1880
2 C. Hodgkinson, Australia, from Port Macquarie to Moreton Bay, 1845.
3 P. Beveridge, The Aborigines of Victoria and Riverina, 1889, p.10-11.
4 Ibid., p. 31.
5 Armstrong, « Manners and Habits of the Aborigines of Western Australia », Perth Gazette, 1836
6 W. Jackman, The Australian Captive, ed. Israel Camberlayne, New York, 1859, p. 200.
7 J. Calvert, The Aborigines of Western Australia, 1894
8 L. Marshall in Man the Hunter, p. 94.
9 A.S. Truswell, J.D.L. Hansen, 1976, « Medical Research among the !Kung », in Kalahari Hunters and Gatherers (ed. by R. Lee and I. DeVore), Cambridge, Mass., Harvard University Press., p 190-9, cité par David Kaplan, « The Darker Side of the 'Original Affluent Society' », Journal of Anthropological Research, Vol. 56, No. 3 (Autumn, 2000), p. 301-324.
10 E. Service, 1966, The Hunters, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, p. 13
11 K. Hawkes, J. F. O'Connell, « Affluent Hunters? Some Comments in Light of the Alyawara Case », American Anthropologist, New Series, Vol. 83, No. 3 (Sep., 1981), p. 622-626.
12 L. Sharp, « Steel Axes for Stone–Age Australians », Human Organization, 1 /1952
13 J.C. Altman, 1992, « Comments on Nurit Bird-David's "Beyond 'The Original Affluent Society."' », Current Anthropology 33:35-36.
Ce livre, paru dans les années 1960, est sans aucun doute un des plus influents qui aient jamais été écrits en ethnologie. Plus souvent cité que véritablement lu, il s'inscrit dans l'abondante littérature qui entendait d'une manière ou d'une autre réhabiliter les sociétés de chasse-cueillette. Il possédait toutefois deux grandes originalités. La première était la notoriété et la qualification de son auteur, un anthropologue de renommée mondiale. La seconde était sa thématique, puisque ce n'était pas pour une fois sur le plan moral, ou spirituel, que les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient censées s'avérer supérieures aux types sociaux ultérieurs, mais sur le terrain même où leur infériorité semblait la plus évidente : celui de la performance économique.
En réalité, Âge de pierre, âge d'abondance rassemble six essais d'inspiration assez dissemblables, dont seul le premier expose et argumente la thèse qui l'a rendu célèbre. Les deuxième et troisième essais traitent du « mode de production domestique », censé caractériser les premières sociétés de cultivateurs. Le quatrième discute du célèbre exposé de M.Mauss au sujet du hau et de l'obligation de rendre un don, tandis que les deux derniers discutent de l'échange dans les sociétés primitives. Le présent billet sacrifiera néanmoins à la tradition : il ne discutera que du premier de ces chapitres, considéré comme la contribution majeure de l'ouvrage.
La démonstration de l'auteur peut être résumée en quatre points :
- Les sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades ont été faussement décrites comme des sociétés de pénurie, dans lesquelles les êtres humains, à la limite perpétuelle de la survie, étaient absorbés en permanence par les nécessités des tâches productives. De telles descriptions, faisant état de « loisirs restreints, sauf circonstances exceptionnelles », d'une « quête incessante de nourriture » en raison de ressources naturelles « rares et incertaines » (p. 39), déjà inappropriées pour les chasseurs-cueilleurs actuels, le sont davantage encore pour ceux du Paléolithique, dont beaucoup bénéficiaient d'environnements plus favorables.
- En réalité, comme le démontrent tant les études circonstanciées que les témoignages ethnographiques, les chasseurs-cueilleurs nomades ne consacrent qu'une part relativement faible de leur temps au travail productif — plus faible, à coup sûr, que dans toutes les sociétés qui ont suivi.
- Ce faible investissement dans les tâches productives n'empêche pas les chasseurs-cueilleurs de pourvoir de manière satisfaisante à leur besoins, en particulier alimentaires. On peut donc renverser la perspective traditionnelle et parler à leur propos de « sociétés d'abondance ».
- Si les chasseurs-cueilleurs nomades ne s'engagent pas dans la voie du stockage, de l'agriculture ou de la sédentarisation, ce n'est pas qu'ils ne le peuvent pas, mais qu'ils ne le souhaitent pas (ce refus du progrès technique évoque singulièrement le « refus » du pouvoir et de l'État invoqué par Pierre Clastres à propos des sociétés amazoniennes — on ne s'étonnera guère que ce dernier ait préfacé l'édition française du livre de M. Sahlins).
La discussion qui suit traitera ces points dans un ordre un peu différent, en commençant par la qualité de l'approvisionnement alimentaire des chasseurs-cueilleurs nomades.
Comment mangent les chasseurs-cueilleurs ?
a) Australie
Les deux principaux exemples ethnographiques sur lesquels s'appuie M. Sahlins, tant en ce qui concerne l'alimentation que le temps de travail, sont les Bushmen et les Aborigènes d'Australie.Sur l'Australie, M. Sahlins remarque fort justement que les zones les plus prodigues, celles qui assuraient à leurs habitants le meilleur niveau de vie, ont précisément été celles où l'occupation occidentale, et l'extermination des Aborigènes, ont été les plus précoces, et pour lesquelles les études précises font défaut. La littérature du xixe siècle, sous les plumes de G. Grey, E.M. Curr, C. Hodgkinson ou J. Eyre, est ainsi convoquée pour souligner l'aisance alimentaire des populations concernées. Cette impression semble peu contestable, et d'autres témoignages la corroborent, tels A. Howitt, qui écrit à propos des Kurnai (qui vivaient 200 km à l'est de Melbourne) :
« On peut difficilement attendre d'une race de sauvages qui errent sur une certaine zone de terrain, et qui dépendent pour leur approvisionnement quotidien de leur capacité à chasser ou à ramasser des plantes, des fruits et des graines, qu'ils fassent des provisions pour le lendemain à moins d'être forcés à la prudence et à la prévoyance par la dure nécessité du besoin. Dans des conditions telles que celles du Gippsland cette nécessité se fera rarement sentir. Les forêts et les plaines herbeuses étaient peuplées de kangourous et d'autres espèces de marsupiaux herbivores; les arbres des forêts abritaient des opossums, l'ours indigène, et des iguanes ; les rivières et les lacs grouillaient de différents poissons et anguilles ; plantes, buissons et arbres variés offraient des racines, des baies et des graines propres à la consommation; et, tant sur terre que sur l'eau, les oiseaux étaient aussi nombreux que divers. La nourriture était, par conséquent, largement présente à travers le pays, et incluait presque tout, depuis les larves des insectes jusqu'au grand kangourou. Dans une région telle que le Gippsland, qui se situe entre l'Océan Pacifique et la grande chaîne enneigée des Alpes Australiennes, il ne peut guère y avoir de sécheresses telles que celles qui ravageaient la plus grand partie du continent. Ainsi, à cet endroit, peut-être moins que nulle part ailleurs en Australie, les Aborigènes étaient-ils conduits par leur expérience à développer des habitudes de prévoyance. 1 »Cependant, on trouve d'autres témoignages qui nuancent cette impression générale, et que M. Sahlins passe sous silence. Ainsi, le même G. Grey cité dans Âge de pierre, âge d'abondance écrit un peu plus loin :
« Il y a néanmoins deux périodes de l'année durant lesquelles [les Aborigènes] sont sujets aux affres de la faim : au plus chaud de l'été, et au plus fort de la saison des pluies. »C. Hodgkinson, également cité par M. Sahlins lorsqu'il vante la sécurité alimentaire des Aborigènes de la région côtière de l'actuelle Brisbane, précise aussi dans son ouvrage :
« Dans les plaines peu boisées, et la région aride au-delà des montagnes qui partagent les eaux orientales et occidentales, les Noirs connaissent des difficultés beaucoup plus grandes à se procurer de la nourriture, et souffrent parfois de famines sévères en période de sécheresse (...) 2 »D'autres auteurs confirment les ce qui précède. P. Beveridge écrit des peuples de la rivière Murray, non loin de Sydney :
« Durant les mois d'hiver, ils endurent les plus extrêmes privations. 3 »
« Ils supportent merveilleusement bien les affres de la faim ; un jeûne d'une semaine entière n'est nullement pour eux un événement rare 4 ».Les mêmes réserves s'imposent à propos du Sud-Ouest semi-aride. Si F. Armstrong affirme que les Aborigènes « n'ont ni souvenir, ni tradition de disette 5 », William Jackman, qui partagea durant plusieurs mois la vie d'une tribu locale, mentionne un déplacement de 500 km durant lequel :
« la famine causée par un temps peu propice à la chasse, qui avait précipité ce long voyage, causa d'incroyables souffrances parmi notre peuple, jusqu'à notre arrivée sur la côte 6 ».Citons enfin J. Calvert :
« En général, ils ont en abondance, bien qu'ils puissent manquer un peu en pleine saison des pluies, ou lorsque la paresse s'empare d'eux par très fortes chaleurs. 7 »Même s'il est impossible de conclure avec précision quant à la situation alimentaire de ces populations, il semble bien que même là où elles jouissaient d'une aisance globale, elles subissaient régulièrement des pénuries — le fait qu'elles les supportaient avec stoïcisme indique au moins autant leur caractère récurrent que mineur. Et dans les zones moins favorisées, ces pénuries pouvaient manifestement devenir critiques.
b) Les Bushmen
| Femmes Bushmen |
À l'appui de leur supposée opulence alimentaire est invoquée l'autorité de Richard B. Lee, qui affirme :
« les Bushmen ne mènent pas, comme on l'a souvent prétendu, une existence en deça de la normale, aux limites de la famine. » (cité p. 63).Cette opinion est néanmoins loin de faire l'unanimité. Lorna Marshall, elle aussi citée, dans un passage où elle écrit pourtant explicitement le contraire (le texte de M. Sahlins multiplie les citations commentées de manière fort orientée) déclarait ainsi lors du colloque Man the Hunter, où M. Sahlins exposait ses vues :
« On a suggéré, parce qu'ils [les Bushmen! Kung] n'ont pas à travailler chaque jour, qu'on pouvait dire d'eux qu'ils avaient une 'société d'abondance'. C'est un bon mot [en français dans le texte], mais cela ne permet pas d'en mieux comprendre la raison. (…) Les !Kung avec lesquels nous avons travaillé sont très maigres et (…) expriment en permanence leur préoccupation et leur anxiété au sujet de la nourriture. 8 »D'autres auteurs, à propos des Bushmen, parlent franchement d'un « cas avéré de demi-inanition », les données laissant penser que :
« les insuffisances caloriques chroniques ou saisonnières peuvent constituer une raison majeure pour laquelle les San [Bushmen] n'atteignent pas la même taille adulte que la plupart des autres gens. 9 »
c) autres populations de chasseurs-cueilleurs
Parmi les autres cas mentionnés par M. Sahlins, se trouvent les Montagnais, une population d'Indiens vivant dans la péninsule du Labrador. Là encore, le texte ethnographique est utilisé d'une manière fort orientée. De ce qu'écrit P. Le Jeune, un jésuite qui vécut parmi eux au xviiie siècle, Sahlins conclut à l'abondance de nourriture :« en temps normal tout le monde trouve à satisfaire ses besoins de subsistance » (cité p. 73).
| Chasseur Naskapi-Montagnais |
« Le mal est qu’il font trop souvent des festins dans la famine que nous avons endurée ; si mon hoste prenoit deux trois et quatre castors, tout aussi tost fut il jour, fut il nuit on en faisoit festin a tous les Sauvages voisins; et si eux avoient pris quelque chose, ils en faisoient de mesme a mesme temps : si que sortant d’un festin vous allez a un autre, et parfois encore a un troisième et un quatrième. Je leur disois qu’ils ne faisoient pas bien, et qu’il valoit mieux réserver ces festins aux jours suivants et que ce faisant nous ne serions pas tant pressés de faim : ils se moquoient de moy ; demain (disoient ils) nous ferons encore festin de ce que nous prendrons : ouy, mais le plus souvent, ils ne prenoient que du froid et du vent... » (cité p. 71)
« Je les voyais, dans leurs peines dans leurs travaux souffrir avec allégresse... Je me suis trouve avec eux en des dangers de grandement souffrir ; ils me disoient nous ferons quelque fois deux jours, quelques fois trois sans manger, faute de vivres prends courage. Chihine, aye l’âme dure, résiste a la peine et au travail, garde toy de la tristesse, autrement tu seras malade ; regarde que nous ne laissons pas de rire, quoyque nous mangions peu... » (cité p. 73)Enfin, M. Sahlins évite soigneusement de mentionner les Inuits, pourtant l'une des populations de chasseurs-cueilleurs les mieux documentées, tant ils cadrent peu avec sa vision idyllique selon laquelle lorsque les chasseurs se déplacent à la recherche de nourriture, c'est dans une « errance (…) nullement inquiète [qui] se déroule (…) avec toute la bienheureuse nonchalance d'un pique-nique au bord de la Seine. » (p. 70). Un pique-nique... où les convives n'auraient pas apporté de provisions, et qui pourraient ainsi devoir être reporté de plusieurs jours et plusieurs nuits.
Certes, M. Sahlins « n'entend pas nier que certains chasseurs sont parfois en difficulté » (p. 78) mais cette remarque n'est rien de plus qu'une révérence polie — on remarquera comment, à propos des Bushmen, il commence par concéder que leur « abondance » ne concerne pas l'alimentation (p. 47-48) avant de s'employer à démontrer l'inverse (p. 61-63). M. Sahlins remplace ainsi une caricature par une autre. À l'image, incontestablement fausse, de chasseurs-cueilleurs uniformément hâves, constamment en situation de survie précaire et tenaillés par la faim, il oppose celle, tout aussi peu réaliste, de populations, même dans les environnements les plus hostiles, à l'abri de tout stress alimentaire notable.
La question du temps de travail
a) une société des loisirs ?
L'autre élément crucial de la démonstration de Sahlins tient au temps de travail : là encore, contrairement au préjugé courant, les chasseurs-cueilleurs nomades ont des loisirs. Beaucoup de loisirs, même, puisque les tâches liées à l'approvisionnement ne les mobilisent que quelques heures par jour — à peine quatre ou cinq. Sahlins rejoignait ainsi un jugement déjà exprimé avant lui par E. Service, selon qui beaucoup de chasseurs-cueilleurs faisaient partie, « au sens strict, des gens qui disposaient du plus de loisirs au monde 10 ».Ce chiffrage s'appuie sur des éléments assez peu nombreux, l'ethnologie s'étant globalement peu intéressée aux questions économiques, encore moins pour produire des données quantifiées. Les deux documents dont dispose M. Sahlins (et qui donnent des résultats convergents) sont une étude menée en 1948 dans le nord-ouest de l'Australie, et les chiffres fournis par R. B. Lee sur les Bushmen. Moins rigoureusement déterminées, mais encore plus frappantes, sont les données reprises de J. Woodburn à propos de Hadza de Tanzanie, qui, « globalement sur l'année [consacrent] probablement en moyenne moins de deux heures par jour à se procurer de la nourriture. » (cité p. 67).
Les conditions de l'étude australienne appellent plusieurs remarques :
- Celle-ci était très limitée dans le temps, observant les groupes sur un maximum de deux semaines.
- Les Aborigènes concernés vivaient dans des réserves, et étaient habitués à être approvisionnés en nourriture « occidentale ». Pour l'anecdote, certains d'entre eux voulurent d'ailleurs renoncer au mode de vie « sauvage » au bout de quelques jours, et il fallut toute la persuasion des chercheurs pour les dissuader de compléter leur menu au supermarché local.
- Ils étaient munis d'outils de métal
- L'étude avait eu lieu durant une saison favorable, et ne permettait donc pas d'inférer une moyenne annuelle.
- Enfin, les groupes étaient exclusivement composés d'adultes en bonne santé. Cette absence d'improductifs, jeunes vieux, réduisait d'autant le temps de travail.
D'autres recherches plaident d'ailleurs dans un sens assez différent. K. Hawkes et J.F. O'Connell 11 estimaient ainsi que le temps de travail chez les Alyawara d'Australie centrale oscillait entre quatre et dix heures par jour, un chiffre de 70 heures hebdomadaires pour les femmes n'étant pas rare. On était très loin des estimations de R.B. Lee ; la différence s'expliquait aisément par le fait que ce dernier ne comptabilisait dans le temps de travail que la recherche de nourriture proprement dite. En y ajoutant le temps passé à traiter et préparer la nourriture ainsi récoltée, on retrouvait les ordres de grandeur proposés par K. Hawkes et J.F. O'Connell.
b) une « simplicité volontaire » ?
Mais la question est peut-être moins de savoir combien de temps les chasseurs-cueilleurs passent à s'approvisionner, que d'interpréter correctement le temps de loisir dont ils disposent. Sahlins assume en effet que ce loisir est un signe de prospérité : les besoins essentiels étant assurés, ces peuples pourraient ainsi se consacrer à leur aise aux conversations, aux visites ou à dormir.
On admet d'ailleurs généralement que ces sociétés ne recherchent pas particulièrement l'augmentation du produit. Une augmentation de la productivité s'y traduit bien moins volontiers par une augmentation de la production que par une réduction du temps de travail ; on cite ainsi souvent le témoignage de L. Sharp à propos des Yir Yiront du Cap York :
« Tout le temps de loisir que les Yir Yiront pouvaient gagner en utilisant des haches d'acier ou d'autres outils occidentaux n'était pas investi dans "l'amélioration des conditions de vie", pas plus que dans le développement d'activités esthétiques, mais dans le sommeil — un art dans lequel ils étaient passés maîtres. 12 »De là, on infère très souvent, à l'instar de M. Sahlins, qu'il existe un véritable « refus de la croissance » chez ces populations, qui considéreraient ainsi l'augmentation de la production au-delà des stricts besoins élémentaires comme une sorte de voie calamiteuse dans laquelle il ne faudrait surtout pas s'engager, et que le loisir dont elles bénéficient serait-il la mesure directe de leur bien-être.
Mais ce supposé renoncement volontaire des chasseurs-cueilleurs pour les biens de ce monde se heurte à un autre constat très largement partagé par les voyageurs et les ethnologues : les chasseurs-cueilleurs des cinq continents, dès qu'ils en avaient l'opportunité, n'étaient pas moins avides que nous des bienfaits de la civilisation matérielle. Ainsi que l'écrit un anthropologue :
« Ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi dans un contexte contemporain, les chasseurs-cueilleurs font souvent montre de besoins matériels illimités plutôt que limités. Comment se fait-il qu'à Momega [Australie] et, selon la littérature, ailleurs, les chasseurs-cueilleurs modernes ont une demande apparemment insatiable de fusils, de carabines, de véhicules à moteur, de magnétophones, de lecteurs CD, de télévisions et de magnétoscopes ? 13 ».Une fois cette observation prise en compte, et au-delà de la discussion sur la durée réelle des loisirs dans ces sociétés, se dessine une autre explication pour ces périodes d'inactivité, qui peuvent résulter bien moins d'un choix que que de la pression de la nécessité. Soit que les chasseurs-cueilleurs aient le ventre creux, mais que les conditions climatiques les condamnent au repos forcé. Soit qu'ils puissent se mettre en quête de fruits ou de gibier supplémentaires, mais qu'une fois l'estomac plein, ils n'aient aucune possibilité d'échanger cette nourriture contre d'autres biens matériels. Tout anachronisme mis à part, le raisonnement qui interprète sans autre forme de procès le loisir des chasseurs-cueilleurs nomades comme un signe de leur prospérité est le même que celui qui, de nos jours, assimile l'oisiveté du chômeur à celle du rentier.
Une certaine idée de l'abondance (ou comment faire de pauvreté vertu)
a) l'art du paradoxe
Le texte de M. Sahlins, quoiqu'il use de formules frappantes, voire provocantes, est en réalité assez sinueux et sa thèse est plus difficile à cerner qu'elle n'en a l'air. Tout d'abord, parce que jouant des clairs-obscurs, il commente des citations d'une manière orientée (c'est une litote), et multiplie les concessions de pure forme qui ne changent en réalité rien à son raisonnement. Ensuite, et peut-être par dessus tout, parce que s'il évite tout vocabulaire technique ou pédant, l'auteur prend un malin plaisir à utiliser des mots ordinaires dans un sens tout particulier et à jouer de ces contre-pieds.Ainsi en va-t-il du concept central d' « abondance » (associé à celui, tout aussi central, de « rareté »). M. Sahlins critique « le sens commun, [pour lequel] une société d'abondance est une société où tous les besoins matériels des gens sont aisément satisfaits. » (p. 37), évoquant une « voie Zen », où « les besoins matériels de l'homme sont finis et peu nombreux, et les moyens techniques invariables, bien que, pour l'essentiel, appropriés à ces besoins. » (p. 38).
On doit donc comprendre de ces phrases que l'abondance, la rareté et les besoins ne sont pas des données objectives, qui se rapportent à des grandeurs indépendantes de l'esprit humain (tels que les besoins caloriques, par exemple) : tout au contraire, c'est la société qui les fixe à sa guise, créant ainsi abondance ou rareté. On ne sera donc pas surpris de lire que la société industrielle, avec son progrès technique inouï, est en réalité marquée par la plus grande pénurie de l'histoire :
« Le marché institue la rareté d'une façon sans précédent et à un degré nulle part atteint. Là où la production et la distribution sont réglés par le mouvement des prix et où tous les moyens de subsistance sont liés au gain et à la dépense, l'insuffisance des moyens matériels devient le point de départ explicite, chiffrable, de toute activité économique. » (p. 40).Inversement, on ne s'étonnera pas davantage que les plus démunis d'entre les peuples puissent être en réalité les plus aisés :
« Est-il à ce point paradoxal de soutenir qu'en dépit de leur dénuement absolu, les chasseurs connaissent l'abondance ? » (p. 40)On connaît ces personnages de dessins animés qui ne chutent dans le précipice que lorsque qu'ils réalisent qu'ils ont les pieds au-dessus du vide. Les sociétés de M. Sahlins sont bien plus étonnantes encore, puisque ce sont leurs propres appréciations sur leurs besoins qui possèdent l'admirable faculté de créer, ou de faire disparaître, les précipices eux-mêmes — à défaut de pouvoir faire l'inverse, il leur suffira d'ajuster leurs besoins à leurs capacités de production pour atteindre l'abondance ainsi définie. Quant à ceux qui aura le mauvais goût de remarquer qu'un changement de définition ne permet en rien de sortir du « dénuement absolu », ils sont sans doute des victimes de leur « ethnocentrisme bourgeois » (p.40).
Mais M. Sahlins croit si peu lui-même à la possibilité de définir l'abondance sur des bases aussi subjectives, qu'il réintroduit par la fenêtre ce qu'il avait bruyamment chassé par la porte, et qu'il tente donc de montrer que les chasseurs sont en réalité fort bien nourris. On a vu les limites de l'exercice ; on pourrait ajouter qu'il faut singulièrement tordre le sens des mots pour qualifier d'abondance des sociétés où le taux de mortalité infantile est de l'ordre d'un tiers.
b) De la chasse à l'agriculture
| L'agriculture, une régression ? |
Si les chasseurs-cueilleurs, affirme M. Sahlins, assuraient leur approvisionnement de manière aussi satisfaisante, et si l'agriculture n'a eu pour effet que d'augmenter le temps de travail tout en diminuant la ration alimentaire individuelle, il ne faut guère s'étonner que certains peuples aient préféré refuser ce prétendu progrès. Le stockage lui-même (rappelons que bien des chasseurs ont pratiqué le stockage bien avant de passer à l'agriculture) apparaît comme peu désirable, tant la sédentarité ne manque pas de provoquer une chute des rendements de la chasse.
Ces explications soulèvent bien davantage de problèmes qu'elles ne sont censées en résoudre. Car si l'on se doit d'expliquer pourquoi certains peuples — à supposer qu'ils étaient réellement en mesure de le faire — n'ont pas franchi les pas du stockage et de l'agriculture, bien plus nombreux sont ceux qui l'ont fait. Or, les théories de M. Sahlins nous laissent totalement désarmés pour comprendre ce mouvement général. « Pourquoi supposer que les chasseurs ayant refusé l'agriculture étaient des imbéciles, et qu'ils n'avaient pas d'excellentes raisons de le faire ? », interroge en substance M. Sahlins. Mais on peut facilement retourner la question, et demander pour quels obscurs motifs tant d'autres peuples ont pu se convaincre d'adopter des modifications économiques censées représenter une régression aussi générale.
Dans son désir de faire feu de tout bois, M. Sahlins en vient à des affirmations proprement étonnantes, comme lorsqu'il affirme que :
« Les peuples primitifs du monde ont peu de biens, mais ils ne sont pas pauvres. Car la pauvreté ne consiste pas en une faible quantité de biens, ni simplement en une relation entre moyens et fins ; c'est avant tout une relation d'homme à homme, un statut social. En tant que tel, la pauvreté est une invention de la civilisation, qui a grandi avec elle, tout à la fois une distinction insidieuse entre classes et, plus grave, une relation de dépendance — qui peut rendre les agriculteurs plus vulnérables aux catastrophes naturelles que les Eskimo d'Alaska dans leurs camps d'hiver. » (p. 80)Dans ce passage, ce n'est qu'au prix d'un double tour de passe-passe que l'auteur nous emmène d'une prémisse incontestable à une conclusion qui défie l'entendement. D'une part, on voit pas pourquoi la pauvreté (qui est certes un concept relatif) devrait concerner uniquement les relations entre individus au sein d'une même société à une même époque. Chacun sait qu'on peut dire qu'un peuple est plus pauvre qu'un autre, ou qu'un même peuple était jadis plus pauvre qu'aujourd'hui, et que ces affirmations ont un sens tout à fait évident. D'autre part, la charge contre la « dépendance » induite par l'agriculture passe allègrement d'une dimension sociale à une dimension technique ; certes, dans les sociétés de classe, les exploités deviennent dépendants des exploiteurs, un phénomène inconnu des sociétés égalitaires de chasseurs-cueilleurs nomades. Mais cette dépendance n'a strictement rien à voir avec celle des différentes sociétés vis-à-vis des variations de l'environnement, dont il faut un certain aplomb pour affirmer que l'agriculture l'aurait augmenté.
Conclusion
Âge de pierre, âge d'abondance entendait dénoncer la vision dépréciative des sociétés paléolithiques inspirée par nos propres préjugés. En réalité, le livre (plus exactement, son premier chapitre, auquel il doit l'essentiel de sa notoriété) construit, moyennant quelques astuces rhétoriques et quelques arrangements avec la réalité, le mythe inverse d'un âge d'or révolu. Bien des pourfendeurs de la « société de consommation » hier, des partisans d'une variété ou d'une autre de la décroissance aujourd'hui, y ont trouvé leur compte. La compréhension scientifique du passé et de l'évolution sociale, elle, mérite mieux que cela.Notes
1 A. Howitt, « The Kurnai : ther customs in peace and war », in Kamilaroi and Kurnai, 1880
2 C. Hodgkinson, Australia, from Port Macquarie to Moreton Bay, 1845.
3 P. Beveridge, The Aborigines of Victoria and Riverina, 1889, p.10-11.
4 Ibid., p. 31.
5 Armstrong, « Manners and Habits of the Aborigines of Western Australia », Perth Gazette, 1836
6 W. Jackman, The Australian Captive, ed. Israel Camberlayne, New York, 1859, p. 200.
7 J. Calvert, The Aborigines of Western Australia, 1894
8 L. Marshall in Man the Hunter, p. 94.
9 A.S. Truswell, J.D.L. Hansen, 1976, « Medical Research among the !Kung », in Kalahari Hunters and Gatherers (ed. by R. Lee and I. DeVore), Cambridge, Mass., Harvard University Press., p 190-9, cité par David Kaplan, « The Darker Side of the 'Original Affluent Society' », Journal of Anthropological Research, Vol. 56, No. 3 (Autumn, 2000), p. 301-324.
10 E. Service, 1966, The Hunters, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, p. 13
11 K. Hawkes, J. F. O'Connell, « Affluent Hunters? Some Comments in Light of the Alyawara Case », American Anthropologist, New Series, Vol. 83, No. 3 (Sep., 1981), p. 622-626.
12 L. Sharp, « Steel Axes for Stone–Age Australians », Human Organization, 1 /1952
13 J.C. Altman, 1992, « Comments on Nurit Bird-David's "Beyond 'The Original Affluent Society."' », Current Anthropology 33:35-36.
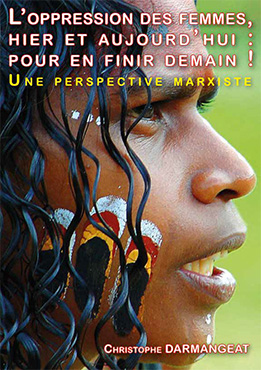

"L'âge de l'abondance" contient une variable sous-entendue et jamais explicitée: la stricte adaptation de la population à la nourriture disponible. Dès que la nourriture devient moins abondante, la population diminue et donne ainsi l'illusion d'un stock de nourriture disponible suffisant. Ce n'est qu'une illusion (et ceux qui sont morts de faim ou ne sont pas nés en ont subit la réalité). La vraie abondance entraîne forcément un accroissement de la population, sauf à considérer une humanité capable de contrôler sa fécondité malgré l'abondance, ce qui me paraît absurde (la bourgeoisie en est venue à contrôler sa fécondité mais pas par abondance, au contraire pour accroître un capital limité, la question des limites s'est juste déplacée de la nourriture au capital).
RépondreSupprimerPas besoin de faire de l'ethnologie pour comprendre cela, la logique et la biologie suffisent. Ce que décrit Sahlins se sont des sociétés totalement dépendantes des aléas naturels et dont la population est régulée par la nourriture disponible dans son environnement, comme les populations animales (surtout de prédateurs). Il est évident que l'agriculture a ouvert la voie à une maîtrise de la production alimentaire et à son accroissement en vue de fournir un stock de nourriture constamment plus élevé que les besoins présents de la population humaine (la véritable abondance, qui entraîne automatiquement un accroissement de la population puisque pas limitée par les ressources).
Bref, vous avez tout à fait raison, Sahlins fait surtout des tours de passe-passe au niveau de la définition des mots.
En quoi cela serait-il un tour de passe-passe ? Cela serait, par exemple, considérer qu'Épicure quand il définit le bonheur est également un simple bidouilleur : son bonheur n'est qu'une absence de malheurs. Ça n'est pas un tour de passe-passe, c'est une définition différente de la votre. D'ailleurs Sahlins insiste beaucoup sur l'idée que l'économie des chasseurs-cueilleurs est une économie de sous-production, qu'elle pourrait produire plus mais qu'elle ne le fait pas, et non pour des raisons "d'aléas naturels", mais pour des raisons purement politiques. Ces constatations sur la marge de productivité potentielle mais non mise en oeuvre dans leur économie vous n'en faites pas état. Est-ce que ces constatations également sont d'insignes manipulations ?
SupprimerPareillement l'agriculture n'a pas permis l'accroissement humain volontaire : elle a changé le régime politique des sociétés et son rapport à la production et l'accumulation. C'est seulement ensuite que, logiquement, elle a nécessité plus de travail, et donc plus de main d'oeuvre. Sinon, si votre hypothèse était tangible, nous aurions observé qu'au moment du passage de la cueillette à l'agriculture la deuxième technique était plus productive que la première. Or ça n'est pas le cas, nous n'avons jamais observé cela, rien ne nous permet de le dire. Ce qui est plus observé, au contraire, c'est que le passage à l'agriculture a augmenté la quantité de travail. Dans ces conditions il faut quand même être de mauvaise foi pour prétendre que la thèse de Salhins, si elle n'est pas sans défaut, ne demeure pas moins plus crédible que la votre.
J'ai lu ce livre en tant qu'étudiant, et à l'époque j'avais beaucoup apprécié sa critique de la vision misérabiliste des chasseurs-collecteurs. Quand on fait un peu de vulgarisation en préhistoire, c'est un cliché auquel on est systématiquement confronté : "à l'époque", ils se gelaient au fond des grottes et ils n'avaient rien à bouffer, alors qu' "aujourd'hui", dieu merci, nous avons la Technique qui nous a apporté le Bonheur - je caricature à peine. Dans une version plus élaborée, des préhistoriens travaillant sur l'évolution des techniques s'appuient (explicitement ou non) sur cette "misère économique primitive" pour dépeindre des chasseurs-collecteurs en quête perpétuelle d'amélioration technique : puisque le système technique "originel" est forcément incapable de produire tout ce qu'il faudrait, les Paléolithiques étaient forcément en permanence en train de chercher à améliorer/optimiser leur armement, leurs techniques de chasse, etc. À mon sens, c'est faux, en tout cas je pense que les données archéologiques ne vont pas dans ce sens... Et par rapport à cela, la thèse de Sahlins a représenté un peu d'air frais, en insistant notamment sur les notions d'adéquation entre moyens (techniques) et besoins (économiques). Et que l'échelle des besoins - les limites entre le nécessaire, l'accessoire, le superflu - soit en grande partie fixée par la société, au-delà d'un certain seuil de satisfaction des nécessités vitales, ça me semble quand même difficilement contestable. Que l'ethnographie sur laquelle repose la thèse soit partielle et partiale, en revanche, c'est une autre histoire, et cette note fournit un très utile retour aux sources ! Le problème étant que nos sources elles-mêmes sont biaisées : en-dehors du cas australien, les chasseurs-collecteurs "ethnographiés" sont le plus souvent des gens qui avaient déjà été repoussés par les agriculteurs-éleveurs dans des régions dont l'environnement n'était pas forcément très sympathique. On n'a donc sans doute pas de sources ethnographiques sur les chasseurs-collecteurs qui vivaient autrefois dans les milieux les plus "confortables", et qui n'étaient pas forcément soumis à un stress alimentaire chronique... Cela dit, je suis d'accord avec le fond de la critique : l'ouvrage de Sahlins a contribué à remplacer un cliché par un autre, critique que l'on pourrait également faire à certaines lectures de Clastres (sur le plan du politique et du rapport au pouvoir) et de Mauss ("culture du don" vs. "culture marchande").
RépondreSupprimerLes exemples que vous employez sont très révélateurs de l'incompréhension que suscite la thèse de Salhins.
RépondreSupprimer"Le mal est qu’il font trop souvent des festins dans la famine que nous avons endurée" : vous en concluez que la famine existe réellement chez les Montagnais, et que leur économie n'est donc pas si idéalement abondante.
Voilà donc des gens qui, durant des périodes de disette, plutôt que de se rationner et d'espacer leurs repas afin d'attendre sereinement la fin de cette période difficile vont au contraire "tout manger", dans des "festins", au point qu'ils passeront les jours suivants à jeuner, à "souffrir avec allégresse". On ne peut pas conclure trente-six mille choses de cette observation ! Deux de chose l'une : soit ces Montagnais sont de parfaits imbéciles, qui ignorent qu'un morceau de viande peut être séparé en deux et que ce deuxième morceau sera encore là le lendemain si on ne le mange pas, soit il y a véritablement une volonté de préférer au rationnement l'alternance d'un festin et d'une disette. Et que cette disette, quoiqu'il en coûte à notre raisonnement occidental, n'est pas de nature suffisamment rude pour avoir raison de la politique du "festin". D'autant que l'on sait que ce n'est pas un problème technique qui leur empêcherait de conserver la nourriture.
La remarque sur les Eskimau est de nature également étonnante. Vous savez bien qu'il s'agit, comme souvent, de peuples qui n'ont pas choisi de leur propre volonté de s'installer dans un environnement aussi hostile : ils y ont été contraints par la pression des peuples sédentaires et agriculteurs. On ne peut pas juger "l'abondance" dont parle Sahlins sur de tels critères. Ou alors il vous faudra admettre que si on place, de la même manière, les peuples sédentaires et agricoles sur les terres de Inuits on remarquera tout autant que leur économie ne fonctionne pas, qu'elle est source de disettes, de souffrance et de famines. Et que même, probablement, les Eskimau s'en sortent mieux.
Pour le passage à l'agriculture, vous dites à Sahlins "on peut retourner votre question". On peut toujours retourner les questions que d'autre viennent de retourner. Pourquoi y'a t il eu globalement passage à l'agriculture ? Premièrement on peut s'interroger sur ce "globalement". N'y aurait-il pas, au contraire, "globalement" des sociétés de chasse et une, récente, parenthèse sédentaire et agricole ? En terme de temps historique, les hommes ont toujours effectivement privilégié une société nomade de chasseurs-cueilleurs. À quel point cela était une volonté, c'est une question compliquée. Mais comment pouvez-vous si facilement conclure que ce n'en était pas une ? Sur quels arguments ? Sur quels exemples ?
La thèse de Salhins est que cela s'est fait sur des raisons politiques, et non une supériorité économique d'origine technique. Evidemment déterminer cela c'est très difficile, mais le fait que l'histoire humaine des chasseurs-cueilleurs soit plus longue que celle des agriculteurs est quand même plus que non-négligeable ! Ou alors il faudrait admettre que tout évènement historique est programmée dans l'histoire de l'homme ? Malgré la difficulté de la question j'ai du mal à ne pas considérer que la thèse politique est plus solide que l'argument de l'invention technique qui s'imposerait comme un évident progrès économique.
Sur la question de la Néolithisation il faut tenir compte du facteur environnemental. Le Néolithique, premièrement, n'a pas émergé en seul point du globe. Plusieurs foyers sont attestés (Proche-orient, Chine, Corne de l'Afrique, Amérique du Sud et sans doute bien d'autres encore) et tous ces foyers ont émergé à la faveur du dernier réchauffement climatique ayant permis le dégèle des sols. La faune et la flore s'en sont également trouvées modifiées, et les premières pratiques agricoles et expériences de domestication des animaux y ont trouvé leur terreau. Il y avait donc "globalement" des populations de chasseurs cueilleurs, qui se sont fait "globalement" aspirées par les divers courants de la Néolithisation qui ont eu raison de presque toutes les populations de chasseurs-cueilleurs. En quelques millénaires la balance s'est inversée.
SupprimerDepuis la naissance d'Homo sapiens sapiens, seulement 3 ères interglaciaire (d'environ 10.000 ans, pour les 2 premières, nous connaissons notre 3ème ère interglaciaire) ont eu lieu, les périodes glaciaires s'étalant plutôt sur 50.000 ans à 100.000 ans.
Si donc la Néolithisation est bien une parenthèse en terme de durée, d'un point de vue culturel, économique, politique, (pré)historique, c'est une révolution sans précédent qui ne peut être réduite à une parenthèse, surtout si l'on considère les impacts écologiques qui en découlent. Les contraintes de la prochaine ère glaciaires nous forceront-elles à ré-adopter des modes économiques de type chasseurs-cueilleurs ? Nos pratiques culturelles se sont si profondément transformées avec la Néolithisation que pour ma part j'en doute.
...Et indépendamment des aspects culturels, cela nécessiterait de réduire de 99% (estimation à la louche) la population mondiale. Pas sûr qu'on trouve assez de volontaires... :-)
Supprimer... sans parler d'abandonner tous les progrès de la médecine, tant physique que psychiatrique...
SupprimerPour finir l'argument sur le chasseurs-cueilleur contemporain friand de lecteurs CD ne peut en aucune manière servir d'invalidation de l'économie de sous-production. Car pour être honnête cela n'a jamais apporté qu'alcoolisme et souffrances supplémentaires aux peuples en question, et que ces mêmes peuples, si ils paraissent friands de consommation le sont nettement moins de l'économie de travail qu'ils devraient mettre en oeuvre pour fabriquer de tels biens. On peut même malignement retourner l'observation : au contact de la simplicité, de nombreux occidentaux finissent par se plaindre de leur excès matériels.
RépondreSupprimerEffectivement, l'exploitation des "indigènes", la spoliation de leurs territoires et autres maux sont une règle générale de leurs rapports avec les civilisations (du moins selon le stéréotype que j'en ai). La question est : peut-il en être autrement ? Je pense que oui.
SupprimerD'autre part comme vous dites le mode économique actuel, capitaliste ultralibéral, n'est guère réjouissant pour les travailleurs, mais comme pour la remarque précédente, ne peut-il pas en être autrement ? Les modèles politiques, économiques et organisationnels sont nombreux et loins de se réduire au capitalisme, comme le montrent les sciences politiques. De même la "souffrance au travail" n'est pas intangible, c'est un phénomène très complexe aux nombreux déterminants, comme le montre la psychologie du travail.
Enfin il y a simplicité et simplicité : si le consumérisme ne me plaît guère, je tiens à garder hôpitaux, et tout le reste de la médecine moderne (et future).
Pour connaître les Améridiens actuels, les Maoris actuels et les Aborigènes actuels, j'ai été choqué par l'argument des chasseurs-cueilleurs modernes préférant le supermarché à la chasse et à la cueillette. Car en dehors des Sentinele des îles andamans et peut-être quelques groupes amazoniens (encore ceux-ci ont-ils une longue histoire de rencontre, même indirecte, même lointaine avec la civilisation thermo-industrielle), je conçois mal des chasseurs-cueilleurs DANS LEUR JUS à l'époque moderne. L'argument me paraît peu recevable, ce qui n'ôte que peu à la thèse selon laquelle M. Sahlins a forcé le trait (mais qu'ont donc fait d'autre Engels à propos des Hurons, M. Baschet à propos du Chiapas, ou encore M. Graeber ? )
SupprimerMerci pour cette critique de l'ouvrage de Sahlins :)
RépondreSupprimerLe titre original anglais du livre est Stone Age Economics, le titre français est peu fidèle.
La définition de l'abondance ne dépend pas de nos désirs. Ce que Sahlins appelle abondance, je l'appelle sobriété, voire ascétisme. Cette sobriété est certainement une très bonne chose pour l'être humain et la société, de même que le jeûne, qui semble avoir des vertus thérapeutiques. Cependant j'ai de la peine à appeler cette sobriété "abondance" sans penser aux substitutions que les politiques affectionnent, comme "force de paix" ou "frappe préventive".
Une denrée est en abondance lorsqu'il y en a plus qu'on ne peut en consommer. Elle peut survenir ponctuellement au moment de la récolte, mais pas nécessairement sur la durée si les denrées ne sont pas stockées, surtout dans les régions à saisons marquées.
En s'appuyant sur quelques exemples, Sahlins affirme que les peuples de chasseurs-cueilleurs ne stoquent pas de nourriture.
Il est certain que de nombreux contres-exemples existent, et selon toute logique d'autant plus dans les régions à saisons marquées. Les amérindiens ont toutes sortes de techniques de stockage de nourriture, notamment les glands, qui étaient enterrés pour ôter leurs tanins mais aussi pour les conserver.
En tant que consommateur régulier de plantes sauvages, je peux affirmer que sous le climat français actuel (qui était certainement plus proche des tropiques pendant la période glaciaire), il est possible de se nourrir sans trop d'efforts. Cela en admettant d'une part une très faible densité d'humains et une forte densité de faune, qui permettraient une chasse et une pêche faciles et abondantes, et d'autre part le stockage de nourriture. Viande, poisson, glands, châtaignes, noisettes et noix apportent largement la dose de glucides, lipides et protéines nécessaires, les autres vitamines et fibres étant fournies par les légumes et les fruits sauvages de saison.
L'homme du paléolithique, s'il n'était pas un imbécile, n'était pas plus un "agent rationnel" que l'homme d'aujourd'hui, comme l'économie conventionnelle le décrit encore. Il n'était pas nécessairement en mesure de décider si oui ou non le passage à l'agriculture apporterait un bénéfice ou non. Les décisions humaines sont généralement prises en se basant sur des croyances et non de manière rationnelle.
Je me souviens avoir lu (peut-être dans un livre de Bill Mollison, mais je n'ai pas réussi à retrouver la page) que les aborigènes pratiquaient une pseudo-agriculture, qui peut difficilement être assimilée à de l'agriculture et est compatible avec un mode de vie nomade de chasseur-cueilleur. Ils favorisaient (plutôt que cultivaient) les plantes et arbres dont ils se nourrissaient. Par ailleurs, si les groupes revenaient régulièrement sur les mêmes emplacements, ce qui est probable, à force de rejeter les graines des végétaux consommés (via les déchets, excréments et oublis), ceux-ci devaient finir par s'installer durablement autour des campements.
J'agis un peu de même autour de chez moi : les noyers, noisetiers, pruniers, pommiers et merisiers se propagent spontanément. Je n'ai qu'à leur faire un peu d'espace pour qu'ils s'épanouissement.
Cette favorisation par l'homme des végétaux qu'il consomme peut difficilement être appelée agriculture. Certains espèces animales font de même. Les ours par exemple (et non les agriculteurs) ont permis l'évolution et la dissémination de la pomme moderne dans son bassin d'origine, au Kazakhstan via leurs excréments et leur préférence pour les meilleurs fruits (cf. le docu "Aux origines de la pomme").
J'ai peur que la "vérité historique" soit inaccessible faute de preuves tangibles. Il serait plaisant d'admettre une thèse qui décrit des sociétés anars avec une économie d'abondance, mais c'est un grand écart intellectuel.
Bonjour William
SupprimerMieux vaut tard que jamais, et je prends enfin le temps de répondre (sur quelques points) à votre commentaire.
La question du stockage chez les chasseurs-cueilleurs est un vieux problème de l'anthropologie : comment englober dans une même catégorie ("chasseurs-cueilleurs") des nomades dépourvus d'inégalités économiques et des sédentaires inégalitaires, comme les Californiens que vous citez (il y avait aussi, plus au nord, les stockeurs de saumon). Alain Testart a apporté une réponse aussi simple que convaincante : la ligne de partage entre les sociétés ne passe pas par le mode d'appropriation de la nourriture (chasse versus agriculture) mais par la présence d'un stockage sur une large échelle. Les Californiens, économiquement et socialement, avaient donc plus de points communs avec les agriculteurs stockeurs qu'avec les chasseurs-cueilleurs non stockeurs.
En Australie, oui, les Aborigènes avaient tout une série de pratiques qui s'apparentaient aux prémisses de l'agriculture. Ils procédaient, notamment, à des mises à feu pour entretenir et renouveler la fertilité de leurs zones de chasse-collecte. Et, dans certains endroits très précis, ils s'adonnaient à des pratiques qui confinaient à l'agriculture. Il n'empêche qu'on ne peut les qualifier d'agriculteurs sans tordre totalement le sens des mots.
Plus généralement, je ne suis pas sûr que les hommes obéissent davantage à des croyances qu'à des pensées rationnelles. Je dirais bien que c'est un mélange subtil et complexe des deux. En revanche, je ne crois pas que les sociétés agissent de manière rationnelle (et encore moins si cette rationalité est censée se faire par anticipation). Dans une société, il y a des individus, ou des classes, qui poussent dans des sens parfois assez déterminés ; mais la résultante, elle, échappe bien souvent à tout processus conscient.
William écrit "Je me souviens avoir lu [...] que les aborigènes pratiquaient une pseudo-agriculture, qui peut difficilement être assimilée à de l'agriculture et est compatible avec un mode de vie nomade de chasseur-cueilleur. Ils favorisaient (plutôt que cultivaient) les plantes et arbres dont ils se nourrissaient. " J'ai lu des choses allant dans ce sens. Ainsi, pour préserver telle graminée du bec des oiseaux, le préleveur (ou la préleveuse, mais cette histoire d'accord est sans fin) noue les graminées en gerbe. A son retour circambulatoire, il se rend compte que la fascine donne des graines plus grosses. Au surplus, s'est formée une motte au pied de la gerbe où sont retenues particules végétales et humidité. De fil en aiguille s'invente (et non pas l'humain invente) l'agriculture. Nul projet, nulle intention. Et peut-être même, lorsque les pleins effets de cette émergence se font sentir n'est-il plus possible de revenir en arrière. Mais on peut toujours inventer ex-post quelque récit, genre Bible, qui fera de l'agriculture une magnifique invention humaine, récit qui servira aussi probablement d'hagiographie aux pouvoirs qui se seront constitués sur la base de la prétendue invention, récit qui dira: "There is no alternative" !
SupprimerLa question qui me tarabuste est celle de la "volonté" de changer, de s'orienter vers l'agriculture plutôt que de rester chasseur-cueilleurs. Une telle volonté implique que l'humain a connaissance du futur: ce futur - l'agriculture par exemple - est désirable et je m'y engage. On sent les thèses téléonomiques d'Hegel. En rappelant, comme le note l'un des contributeurs, que la chasse-cueillette occupa la plus grande part de l'histoire de l'humanité et que donc elle dut constituer une forme d'économie viable (oui, oui, beaucoup de morts de famine et de d'épidémies, mais moins que les récents conflits mondiaux), j'en reviens à l'idée d'intentionnalité quant au "choix de l'agriculture". Car si nous avions anticipé la catastrophe globale présente, aurons-nous suivi Jésus et son appel à "croître et multiplier" ?
RépondreSupprimerUn exemple quant au libre arbitre putatif derrière les choix humains: celui des noms de peau aborigène. Ce système double le système clanique en attribuant un "nom de peau", indépendant de son appartenance clanique à chaque individu, interdisant au titulaire d'un nom de peau donné de copuler (frotter les peaux) avec un titulaire du même nom de peau. Il a fallu l'aide de l'informatique pour comprendre que ce système très simple évitait (statistiquement significativement sinon à coup sûr) les unions consanguines, qui dans de petites communautés humaines aboutit en peu de générations à de graves problèmes de santé (l'une des raisons pour laquelle nombre d'exemples ces petites communautés se rassemblaient périodiquement en larges assemblées). Evidemment, les aborigènes n'avaient pas d'ordinateurs.
Dès lors la question est celle-ci: comment un tel système, dont les conséquences ne se sentent qu'au delà de l'horizon d'une vie humaine, a-t-il pu se mettre en place ? Qui l'a inventé ? Un détour par la biologie n'est pas ici inutile: la cornée de l'oeil de poulet présente des photo-récepteurs disposés aléatoirement: on a pu montrer que cette conformation assurait une meilleure vision (un motif qui serait aligné sur la grille de la cornée serait invisible). Ici, bien sûr, il faut convoquer la pression sélective. Mais alors pourquoi penser que l'organisation politique et économique des sociétés humaines seraient l'expression d'un choix, d'un libre arbitre plutôt que d’un enchaînement de causes et conséquences hors de portée de l’esprit humain ? Et ce d'autant que, contrairement à une solide croyance, les espèces peuvent se fourvoyer dans des cul de sac évolutifs, que les corps sont loin d’être des machines biologiques optimales. Ainsi, les cultures sont des voies non pas choisies, mais d'abord subies, aveugles, dont l'horizon dépasse l'entendement humain. (suite au prochain commentaire, la machine me disant que je suis trop long).
(suite du précédent commentaire par le même auteur)
SupprimerLe même genre de question se pose lorsqu'on considère les architectures complexes (et parfois énormes: un dizaine de mètres de profondeur pour des centaines de millions de termite) de certaines termitières. Où est la termite architecte ? Qui a les plans ? Or, cet être collectif qu'est la termitière peut-être comparé à une colonie de cellules cérébrales, bref, un cerveau, celui-là même qui nous présente nos réalisations comme étant NOTRE oeuvre, ce qui n'est probablement que marginalement le cas. L'idée que nous nous faisons du temps, de la causalité, i.e. de la consécution cause conséquence, de ce qu'est un agent, est probablement viciée à la base. Nous pouvons constater, mais pas expliquer (Kant, en substance), surtout pris en compte les énormes imperfections et biais de l'entendement humain.
A noter pour finir que cette critique est celle qu'adresse à l'Occident l'islam intégriste, la Chine ou la Russie. Leurs philosophies sont loin d'être ma tasse de thé (c'est une litote), mais nous soumettent à une critique radicale. Et sans tomber dans le néo-obscurantisme latourien, descolien et surtout stengérien (I. Stenghers), nous devons l'entendre et notamment explorer la métaphysique scientifique implicite qui, pour trop de scientifiques, se pense comme un naturalisme irréfragable, comme il s'est vu dans le surréaliste échange entre Jean Jouzel (GIEC) et M .Pouyanné (pdg de Total) qui répondit au premier: "moi, monsieur, je suis dans le réel".
Sur ces questions et d'autres (notamment une proposition de réjuvenation de la démocratie par un tirage au sort bien tempéré), on peut lire "Tirage au sort et imparfaites démocraties", d'Etienne Maillet (ma pomme) aux Editions Yves Michel.
Juste un mot sur "cul de sac évolutif", qui me semble être une idée du XIXe siècle. En tous cas, c'est une idée anti-darwinienne. Les organismes varient, et l'environnement varie aussi : il n'y a donc pas, pour une espèce, d'adaptation ni d'inadaptation dans l'absolu. Mais c'est une idée jadis magnifiquement illustrée par J.-H. Rosny Aîné dans La Guerre du feu (1909, 1911) avec ses personnages les "Wah", ou dans Vamireh (18..) avec ses "Tardigrades". Je trouve triste du point de vue des connaissances, mais fascinant du point de vue des croyances, que cette idée soit encore répandue aujourd'hui ! C'est un peu comme "le fossile vivant" ou "l'homme des cavernes"...
RépondreSupprimerPour le reste, il me semble que Christophe Darmangeat a très bien expliqué que les décisions des individus sont (au moins en partie) rationnelles, tandis que celles des sociétés ne le sont pas. Précisément parce que les sociétés s'engagent dans telle ou telle voie, non pas par l'effet d'un consensus de ceux et celles qui les composent, mais sous la pression d'un grand nombre de forces individuelles divergentes, dont la résultante est quasi-imprévisible.
Marc Guillaumie.
Pardon : Vamireh, 1891.
RépondreSupprimerM. G.
Je reprends encore la parole pour illustrer et défendre un peu, dans cette discussion très rationnelle, l'astuce, l'inventivité et la vérité de la fiction.
RépondreSupprimerDans son roman "Daâh" (1914 ; réédité plusieurs fois depuis les années 1990), Edmond Haraucourt montre un grand nombre d'inventions techniques, supposément faites par son héros préhistorique. Contrairement aux a priori utilitaristes qui régnaient à son époque chez les anthropologues (préhistoriques sous-alimentés, terrifiés par les fauves, etc., donc avides de techniques nouvelles "pour survivre"), Haraucourt ne montre pas Daâh soucieux d'efficacité. Du moins, pas dans un premier temps. Ce qui compte d'abord, pour lui, c'est le jeu et le prestige. Le meilleur exemple est à la fin du roman, quand Daâh s'approprie un tison, une branche enflammée par hasard : il ne peut pas savoir, avant d'en avoir fait longuement l'expérience, que le feu pourra lui être utile en quoi que ce soit. La question est donc : pourquoi Daâh veut-il acquérir le feu ? Et le roman donne cette réponse : par amour de tout ce qui brille, par bravade, pour impressionner sa bande...
Ça me paraît une hypothèse beaucoup plus fine et plus vraisemblable que les représentations qui ont régné jusque dans les années 1970, et même plus tard : des préhistoriques misérables venant se réchauffer la carcasse et griller quelques maigres proies, auprès d'un feu naturel découvert par hasard. Je crois que beaucoup de progrès techniques sont le fruit du jeu. L'émulation, le goût du prestige, le plaisir de la recherche pure sont sans doute un aiguillon, bien davantage que le souci de l'efficacité. Aujourd'hui encore, c'est ce que montrent les autobiographies de savants.
Ceci vaut pour l'individu, à mon avis. Quant aux raisons pour lesquelles une société toute entière adopte l'innovation proposée par un individu, c'est autre chose.
Marc Guillaumie.